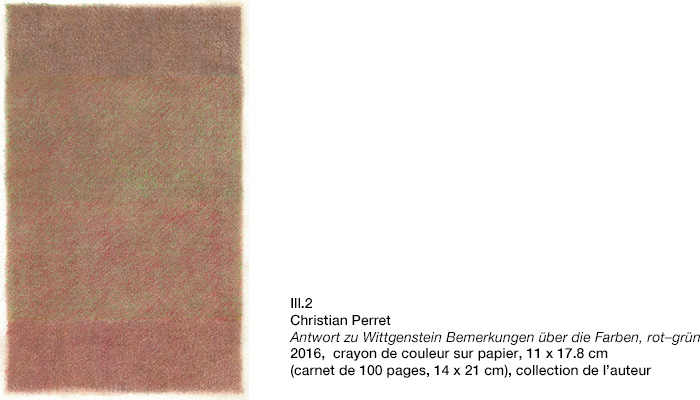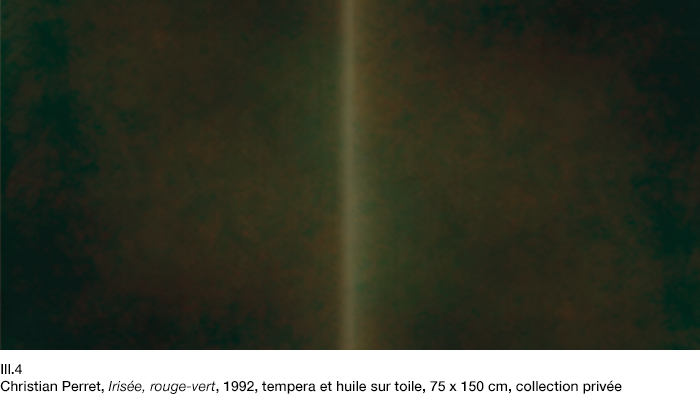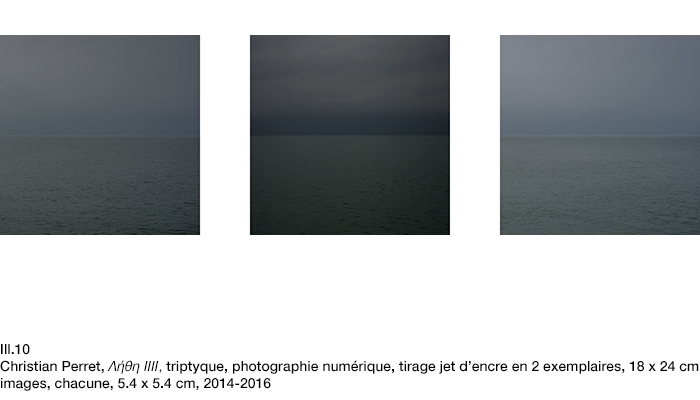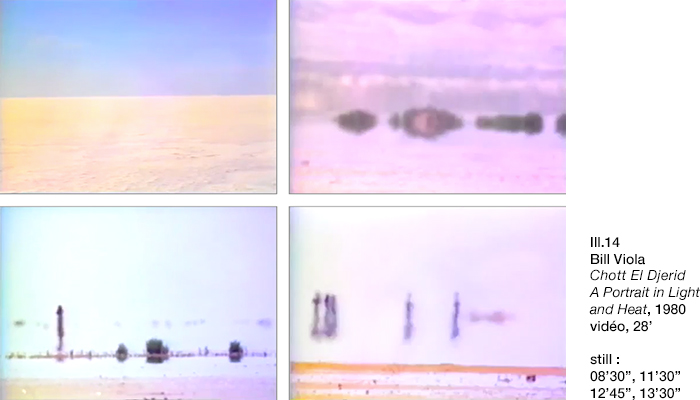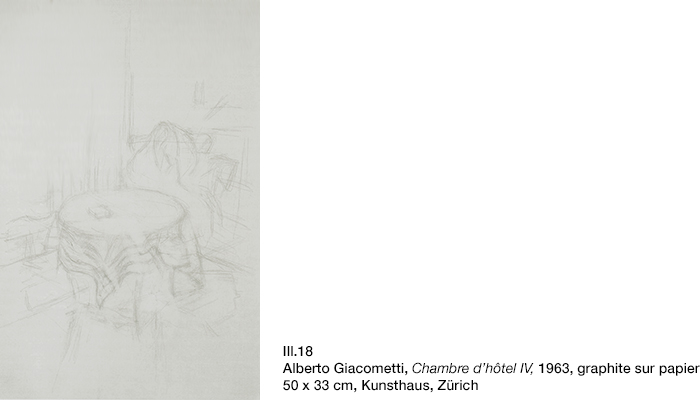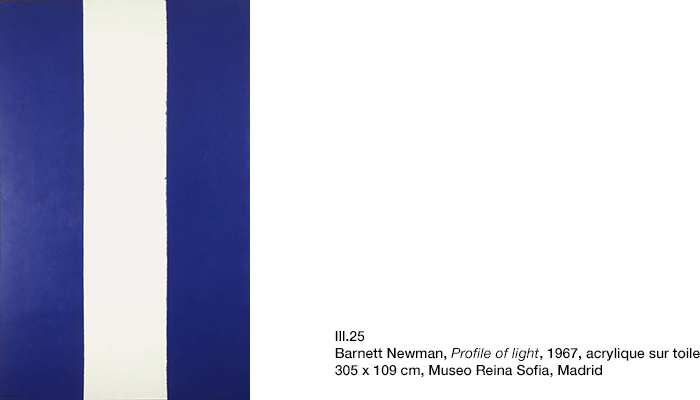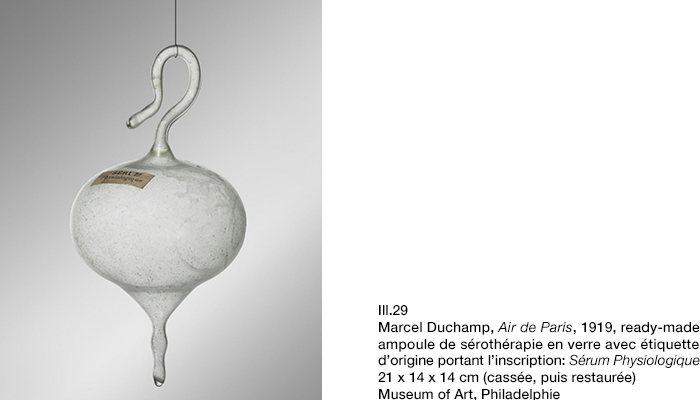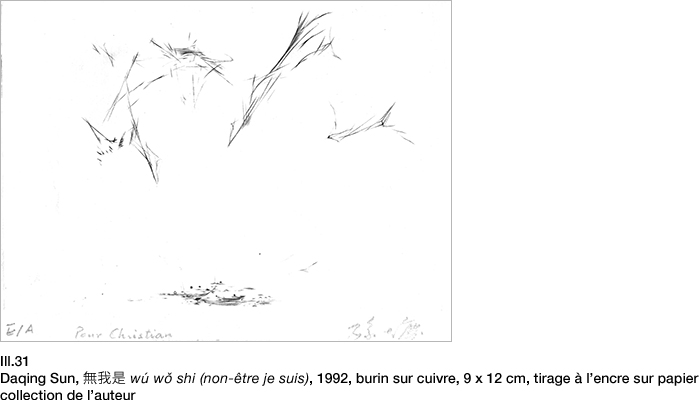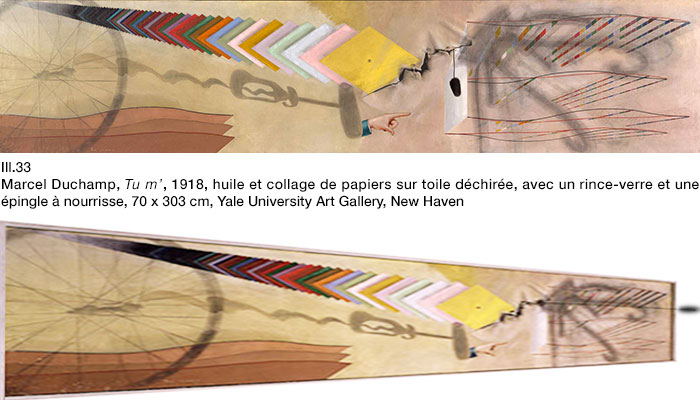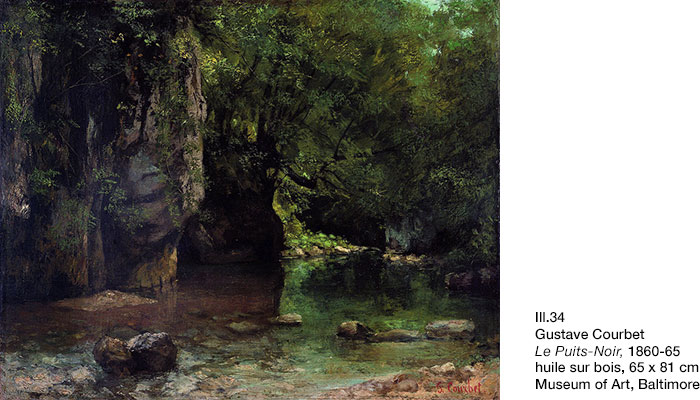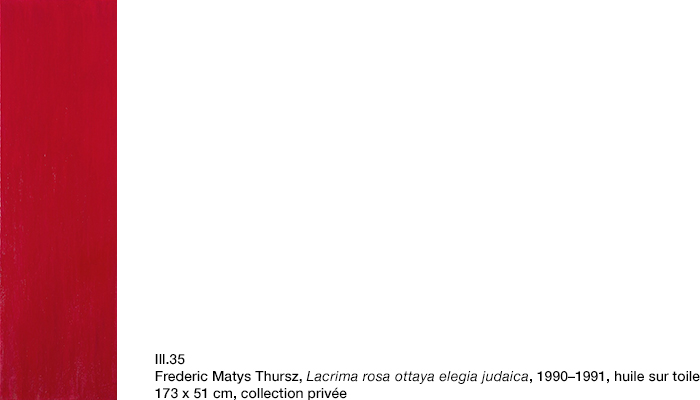1. L’expression est extraite d’Ulysses de James Joyce, p. 45, pensée par Stephan Dedalus dans son
monologue-errance sur la plage de Sandymount, en prise avec la (im)possibilité
de décrire la perception, voire de la (in)conscientiser. Le concept est
emprunté au Laocoon de Lessing, qui y
postule que dans l’image, l’action narrative est lisible si les différents
moments (l’un après l’autre) coexistent dans l’espace l’un à côté de l’autre.
2. A-figuration : j’entends par là une sorte de non
figuration, quoique non sous son sens négatif (qui pourrait supposer un versant
positif ou un contraire tel “abstraction”), mais sous son aspect privatif
(privé de figuration, sans autre versant ou contraire possible). J’étendrai cet
usage ; ainsi trouvera-t-on “a-perception”, “a-coloration”, etc. ou une
même utilisation des préfixe “dé-”, tels ”dé-faire”, “dis-” ou d’autres
préfixes indiquant le privatif. Afin de marquer l’intentionnalité de cette
privation, le manque qu’elle creuse, l’absolu écart, la contradiction ouverte
en question sans réponse possible, la graphie au tiret long, tels “a–figuration”, “dis–paraître”,
“in–visible”, voire “haut–bas”, etc. sera utilisée, laissant au
tiret court la possibilité d’une conjonction, ainsi de :
“monologue-errance”.
3. Extrait
du poème Hafen, de Paul Célan, in »Atemwende« .
4. Extrait du poème Der Schnee, de Robert Walser, in »Der Schnee fällt nicht hinauf
5. Sur le
(quasi) concept de « différance » voir Jacques Derrida, Marges de la philosophie.
6. Maurice
Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, p.
19.
7. Runge, Lettre à Goethe, reproduite par Goethe
dans son Traité des couleurs, citée
par Ludwig Wittgenstein, Remarques sur
les couleurs (I, 21)
8.
Wittgenstein, Remarques sur les couleurs
(III, 30)
9. Idem
(III, 163). Voir également les Remarques suivantes :
I, 9 :
« Toutefois, même si le vert n’est pas une couleur intermédiare entre le
jaune et le bleu, ne pourraît-il y avoir des gens pour qui existerait un jaune
tirant sur le bleu, un vert tirant sur le rouge ? Des gens par conséquent
dont les concepts de couleur s’écarteraient des nôtres – puisqu’aussi
bien les concepts de couleur des daltoniens s’écartent déjà de ceux des gens
normaux, et qu’il n’est pas nécessaire que tout écart par rapport à la norme
constitue une cécité, un défaut. »
I,
10 : « Prenons maintenant quelqu’un qui a appris à trouver un ton
plus jaune, plus blanc, plus rouge qu’un ton donné, ou à le mélanger, etc.
– quelqu’un donc qui possède le concept de couleur intermédiare –
et invitons-le à nous montrer un vert tirant sur le rouge. Il se peut qu’il ne
comprenne tout simplement pas un tel ordre et qu’il réagisse à peu près comme
si on avait exigé de lui qu’après nous avoir montré un polygone régulier à quatre,
cinq ou six angles, il nous en montrât un à un seul angle. Mais que se
passerait-il si, sans hésiter, il nous indiquait un certain échantillon de
couleur (disons, une sorte de brun-noirâtre, comme nous le
nommerions ? »
I,
11 : « Quelqu’un pour qui un vert tirant sur le rouge serait quelque
chose de bien connu devrait être capable de produire une série de couleurs qui
commencerait avec le rouge et finirait avec le vert, et qui formerait,
peut-être également pour nous, une transition continue entre ces deux termes.
On s’apercevrait alors que là où nous voyons chaque fois le même ton (par
exemple le même ton de brun), il verrait, lui, tantôt un brun, tantôt un vert
tirant sur le rouge. On s’apercevrait par exemple qu’il serait capable de
distinguer quant à la couleur deux compositions chimiques qui, pour nous,
possèdent la même couleur, et qu’il nommerait l’une brune et l’autre
vert-tirant-sur-le-rouge. »
10. Allusion
au ready-made Fountain, urinoir signé
R. Mutt 1917, de Marcel Duchamp, duquel il sera plus tard question, voir les
parties titrées : A–percevoir,
à concevoir ; A–concevoir
et Zéro infini.
11. Maurice
Blanchot, La pensée et l’exigence de
discontinuité, in « L’Entretien infini », pp. 5-8. Citer ceci ici
est non seulement constation de l’avtivité d’enseignement que je conduis depuis
1994, c’est aussi penser la possiblité d’un déplacement de cette argumentation
dans la pratique artistique : au maître substituer l’artiste, émetteur, à
l’élève le “regardeur”, récepteur. Ce point sera repris dans la partie titreée Entre-deux à propos de la performance The Artist is Present de Marina Abramović.
12. Toile
de coton ou de lin montée sur châssis, enduite de colle de peau de lapin, puis
de cette colle avec un blanc de chaux – ou un ocre, une sienne brûlée,
quelque terre brune de prédilection.
13. Xavier de Langlais, La Technique de la peinture à l’huile, p. 228 : « Peinture brillante à la térébenthine de
Venis et au siccatif de Harlem.
[…]
Agglutinant.
(A ajouter
aux couleurs du commerce, en tubes, à raison de 10 gouttes pour le volume d’une
noix de couleur)
| baume de thérébentine de Venise : | 20 grammes |
| essence de thérébentine ordinaire : | 40 grammes |
| siccatif de Harlem : | 15 grammes |
| huile de lin polymérisée : | 15 grammes |
Diluant.
(Pour servir de vernis à peindre en cours
d’exécution)
| baume de thérébentine de Venise : | 10 grammes |
| essence de thérébentine ordinaire : | 40 grammes |
| siccatif de Harlem : | 30 gouttes |
| huile de lin polymérisée : | 30 gouttes » |
Technique personnelle pour épaissir le glacis
et le rendre plus émaillé :
Ajouter à l’agglutinant mêlé de couleur du
jaune d’œuf, dans la proportion du quart du volume ; chauffer le mélange
au bain-marie, sans bouillir, et laisser refroidir une journée. Est obtenue une
pâte transparente et vitrifiée que l’on peut poser en aplat avec une brosse
large (glacis de grande surface) ou en épaisseur avec un pinceau fin (détail,
telle la brillance d’une perle chez Van Eyck).
14. Voir Heidegger, Etre et temps ; reste que le mot « Dasein » à la traduction
heideggerienne si complexe (être là, être-le-là, être-l’ici-et-le-maintenant,
être-ancré-situé-dans-le-temps) est usité avant Heidegger dans le sens commun
d’exister, par exemple par Brückner, qui clôt (in-achève) son Lenz, par la phrase : […]sein Dasein war ihm eine notwendige Last. – So
lebte er hin.« - traduite par Dietrich en :
« […] son existence était pour lui un fardeau nécessaire. C’est ainsi que
se passait sa vie [c’est ainsi qu’il vécu en soi – qu’il in-vécu]. » Un
existé qui dans la culture allemande a sa charge.
15. Sur le concept de parution, voir en
particulier les ouvrages de Jean-Luc Marion, dont Etant donné ; essai d'une phénoménologie de la donation.
16. Heidegger, Remarques sur art, sculpture, espace, p. 27 : « Qu’est-ce
donc que l’espace en tant qu’espace ? Réponse : l’espace espace [Raum räumt]. Espacer signifie : essarter, dégager, donner du
champ-libre, de l’ouverture. Dans la mesure où l’espace espace, il libère le
champ-libre et avec celui-ci offre la possibilité des alentours, du proche et
du lointain, des directions et des frontières, la possibilité des distances et
des grandeurs. »
17.
Diderot, La Raie de Chardin au Salon de
1763.
18. Celui de Marcel Proust décrivant la mort de
Bergotte devant La Vue de Delft de Vermeer
dans La Prisonnière, Folio, pp. 176-177
(voir la partie titrée Entr’ aperçues
de cette étude)
19. James
Joyce, Ulysses, pp. 45-46. Traduction
française : Ulysse, trad.
Morel, Folio, vol. 1, pp. 55- 56 :
« Inéluctable
modalité du visible : tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé à travers
mes yeux. Signatures de tout ce que je suis appelé à lire ici, frai et varech
qu'apporte la vague, la marée qui monte, ce soulier rouilleux. Vert-pituite,
bleu-argent, rouille : signes colorés. Limites du diaphane. Mais il ajoute :
dans les corps. Donc il les connaissait corps avant de les connaître colorés.
Comment ? En cognant sa caboche contre, parbleu. Doucement. Il était chauve et
millionnaire, maestro di color che sanno.
Limite du diaphane dans. Pourquoi dans ? Diaphane, adiaphane. Si on peut passer
ses cinq doigts à travers, c'est une grille, sinon, une porte. Fermons les yeux
pour voir.
Maintenant ouvre les yeux. Oui, mais pas tout de suite. Si
tout s’était évanoui ? Si en les rouvrant je me trouvais pour jamais dans le
noir adiaphane ? Basta. Je
verrai bien si je peux voir.
Regarde maintenant. Tout est demeuré à sa place hors de toi :
maintenant et à jamais, dans tous les siècles des siècles. »
20. 20. Montherlant, Henry de, Les Bestiaires, in « Trois romans: Le Songe, Les Bestiaires, Les Célibataires », p. 375.
21. Verklärte Nacht (Nuit éclairée ou « Nuit
transfigurée »), sextuor à corde d’Arnold Schönberg, op. 4, 1899.
22. Exemple
non-visuel des plus probants : l’effet produit par le Continuum pour clavecin de Georgy Ligeti.
23. Marcel
Proust, extrait de Jean Santeuil,
cité par Georges Raillard, Peindre qu’on
ne voit pas, in « L’Ecrit du temps » N° 17, p. 77.
24. Maurice
Blanchot, Thomas l’obscur (nouvelle version), pp. 15-18.
25. Voir la thèse kantienne séparant phénomène et noumène,
développée par Husserl puis par la phénoménologie. Cf, particulièrement :
Kant, Critique de la raison pure et Critique de la faculté de juger ;
Husserl, Idées directrices pour une
phénoménologie (Ideen I), Méditations cartésiennes et Problèmes fondamentaux de la phénoménologie ;
Merleau-Ponty, L’Œil et l’esprit, Le Visible et l’invisible et Phénoménologie
de la perception.
26. Maurice
Blanchot, L’Espace littéraire, pp.
26-31.
27. Paul
Celan, Der Meridian, Rede anläßlich der
Verleihung des Georg-Büchner-Presises, Darmstadt, an 22. Oktober 1960 in
« Le Méridien et autres proses », pp. 71-72, trad. Launey :
« … “simplement il lui était parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur
la tête.”
Celui qui
marche sur la tête […], – celui qui marche sur la tête, il a le ciel en
abîme sous lui. »
28. Maurice
Blanchot, L’Espace littéraire, p. 21.
29. Voir la
description de Gabrielle Dufour-Kowalska, Caspar
David Friedrich, pp. 105-110 : « Le tableau se divise en trois
parties […] formant trois plans superposés qui se donnent immédiatement comme
tels, plutôt qu’en perspective.
[…] Le
paysage n’inclut aucune verticale, mais il n’oriente pas non plus le regard
selon une perspective horizontale.
[…] A trois
parties qui divisent le tableau correspondent […] trois éléments : la
terre, l’eau et l’air […]. [Une] densité en profondeur et sans volume confère
une dimension nouvelle aux trois éléments représentés, transforme leur être
naturel et extérieur en substance qui se referme sur soi et s’ouvre en dedans
sur le modèle intérieur, présent et insaisissable en chaque point du tableau.
L’élément
terrestre, liquide ou aérien remplit tout l’espace, se substitue à son réceptacle
vide, et abolit son extension naturelle. Le tableau éveille un sentiment de
plénitude en même temps qu’il gêne le regard, mettant le specateur mal à
l’aise, à moins que ce dernier ne s’abandonne au jeu des éléments réducteurs et
consente à regarder autrement, à travers les formes ou plutôt l’absence de
formes.
[…] [La]
petitesse infime [du moine] signifie moins la présence dérisoire de l’homme
dans l’immensité de l’univers – c’est l’interprétation la plus courante
– que le pur regard […]. Cest le regard des “yeux auxquels on a coupé les
paupières” [Kleist], un regard corrélatif d’un espace total et un, qui ignore
le divers et le multiple et contemple un paysage dans lequel il n’y a rien à
voir. Il n’est pas orienté par un objet quelconque, il a cessé de se projeter
au dehors et se réduit à son flux intérieur. Le moine symbolise [?] la pure
subjectivité du regard.
[…] La
situation inconfortable du specateur [est celle de] l’impossibilité de voir et
de vivre le paysage de Friedrich, le non voir auquel est condamné notre regard
devant la mer “absente”. Regard d’yeux sans paupières, qui a perdu l’usage
normal de la vue […] [ayant perdu toute perspective, toute orientation,
toute capacité de saisie face au vide et à une substance qui abolit l’espace.] »
30. Maurice
Blanchot, L’Espace littéraire, pp. 170-172.
31. Idem,
p. 341 (annnexe II, Les Deux versions de
l’imaginaire).
32.
Nietzche, Nachgelassene Fragmente
7(64), 1883 ; Fragment posthume 7(64) in « La Naissance de la
tragédie », p. 193.
33. A ce propos, les séries de Sophie Calle sur Les Aveugles, quoique exposition très
littérale inspirée du texte de Diderot (Lettre
sur les aveugles), apporte quelques indices, dont cette réponse :
« La beauté, je suis ennuyé de la beauté. Je ne veux pas de la beauté ou
des images dans ma tête qui la représente. Puisque je ne peux pas l’apprécier
je m’enfuis chaque fois que je peux pour ne pas la rencontrer ». Ce
témoignage, mis en scène comme toute la série (portrait photographique de
l’aveugle, texte de ses paroles, image photographique illustrant son dire)
n’est, c’est sa force, accompagné d’aucune image.
34. Exactement comme l’image prégnante de l’œil “tranché”
par la lame de rasoir dans Un Chien
andalou, film de Buñuel et Dali.
35. Heinrich von Kleist, Article
sur Le Moine au bord de la mer de
Caspar David Friedrich, cité par Gabrielle Dufour-Kowalska, Caspar David Friedrich.
36. Maurice Blanchot, La
Folie du jour, pp. 17-20
37. Marcel Proust, La
Prisonnière, pp. 176-177, décès de Bergotte dont l’intégralité du passage
est le suivant :
« Il mourut dans les circonstances suivantes : une
crise d’urémie assez légère était cause qu’on lui avait prescrit le repos. Mais
un critique ayant écrit que dans la Vue
de Haarlem de Ver Meer (prêtée par le musée de La Haye pour une exposition
hollandaise), tableau qu’il adorait et croyait connaître très bien, un petit
pan de mur jaune (qu’il ne se rappelait pas) était si bien peint qu’il était,
si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d’art chinoise, d’une beauté
qui se suffirait à elle-même, Bergotte mangea quelques pommes de terre, sorti
et entra à l’exposition. Dès les premières marches qu’il eut à gravir, il fut
pris d’étourdissements. Il passa devant plusieurs tableaux et eu l’impression
de la sécheresse et de l’inutilité
d’un art si factice, et qui ne valait pas les courants d’air et de
soleil d’un palazzo de Venise, ou d’une simple maison au bord de la mer. Enfin
il fut devant le Ver Meer qu’il se rappelait plus éclatant, plus différent de
tout ce qu’il connaissait, mais où, grâce à l’article du critique, il remarqua
pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose,
et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses
étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à
un papillon jaune qu’il veut saisir, au précieux petit pan de mur. “C’est ainsi
que j’aurai dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait
fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même
précieuse, comme ce petit pan de mur jaune.” Cependant la gravité de ses
étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui
apparaissait, chargeant l’un des plateaux, sa propre vie, tandis que l’autre
contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu’il avait
imprudemment donné la première pour le second. “Je ne voudrais pourtant pas, se
dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition.” Il
se répétait : “Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur
jaune.” Cependant, il s’abattit sur un canapé circulaire ; ainsi
brusquement il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à
l’optimisme, se dit : “C’est une simple indigestion que m’ont données ces
pommes de terre pas assez cuites, ce n’est rien.” Un nouveau coup l’abattit, il
roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il
était mort. »
Si pour E. Robert (notes de l’édition Gallimard Folio, p.
429) le petit pan se trouve à l’extrême droite du tableau, parmi multiples murs
jaunes, ce même si on y perçoit pas d’auvent mais la partie supérieure d’un
pont basculant ; pour J. Pavent, Les
Ecarts d’une vision, présentation de l’extrait du texte dans Proust, Petit pan de mur jaune, La Différence,
p. 45), il est également à l’extrême droite « sur lequel déborde à gauche
l’auvent de la toiture d’une maison voisine » - ce se reprenant de
l’évidence de l’avoir d’abord vu, sous la parole d’une guide (« petit pan
de mur jaune, du reste, qui n’est pas un mur mais un toit ») en toiture,
au dessus de la muraille qui joint la fortification portuaire et la bâtisse qui
le suit. Pavent démontre par ailleurs l’intérêt à ce déport perceptif vers le
« moins évident ».
38. Stéphane Mallarmé, Le
Démon de l’analogie in « Divagations », éditées dans Igitur, Divagations, Un Coup de dés, pp.
85-87 (pagination Gallimard Folio).
39. Emmanuel Kant, Critique
de la faculté de juger, § 23.
40. Idem, § 27.
41. Idem, § 23.
42. Bill Viola, Chott
El Djerid, A Portrait in Light and Heat, projeté en RVB au Centre pour
l'image contemporaine Saint Gervais, Genève, 1993
43. Rares
sont sans doutes les ouvrages qu’à lecture on eu voulu écrire, sincèrement,
parce qu’on aurait pu les écrire, réellement – seul le manque de temps,
d’autre choix, la vie et ses circonstances faisont que l’on aurait été précédé.
Ainsi pour moi de la thèse doctorale de Benjamin Delmotte, Le Visible et l’intochable, la
vision et son épreuve phénoménologique dans l’œuvre d’Alberto Giacometti, où
le concept de désapparation est posé, développé, discuté à l’aulne de
l’évolution de la phénoménologie et ses conséquences esthétiques révélées. Je
ne citerai pas ici des parties de cet ouvrage, tant la citation serait
paraphrase presque intégrale de l’entier de son contenu, lu novembre 2016, bien
après les descriptions que j’ai effectuées – pour moi, des visions que je
pouvais porter sur Giacometti.
44. Rilke, Duineser Elegien [Elégies de Duino],
extraits des quatrième et première Elégies
45. Maurice
Blanchot, Thomas l’obscur, roman (1941),
pp. 12-13. La citation exacte est : « De même quand il se mit
à marcher, il se pencha en avant avec une répugnance visible, et l’on pouvait
croire que c’était non pas ses jambes, mais son désir de ne pas marcher qui le
faisait avancer. »
46. Sur le
contre-don, voir la notion de potlatch,
telle que développée par Marcel Mauss dans son Essai sur le don.
47. Emmanuel
Kant, Critique de la faculté de juger, §
27.
48. Idem, § 29.
49. Idem,
§ 26.
50. Idem,
§ 23.
51. Ce
suivant plus Sartre que Kant, puis Hüsserl, voir en particulier L’Imaginaire.
52. Cette
citation et les suivantes sont relecture découpée de la mort de Bergotte,
suivant la vue du petit pan de mur jaune dans La Prisonière, de Proust, pp. 176-177.
53. Un
point explicatif s’impose sur cette confrontation à poser comme sorte de
com–paraison. Si l’on compare deux pommes, tout au plus pourra-t-on dire
que l’une est plus jaune, l’autre plus rouge (la comparaison de deux mêmes
renvoyant chaque élément à lui-même). Si l’on compare une pomme et une poire,
tout au plus pourra-t-on dire qu’un des fruits est plus acide, l’autre fruit
plus doux (la comparaison de deux semblables les renvoyant à ce qui les rend
semblables, ce qui est et l’un et l’autre). Si l’on compare une pomme et un
lac, alors se produit parfois la possibilité que la comparaison de ces deux
absolus dissemblables face advenir un terme, une idée, un concept qui n’était
ni dans un terme, ni dans l’autre, ni à leur conjonction ; soit quelque chose
de tout à fait innatendu. Il s’agirait, dans l’apparent illogisme de la
méthode, d’une com–paraison qui fait paraître de l’autre plutôt que du
même ou du commun. C’est cette tension que je tente ici, à la manière de la
célèbre « rencontre fortuite sur une table de dissection d'une
machine à coudre et d'un parapluie » (Lautréamont, réemployé par Breton
et les surréalistes).
54. Chardin préparait aussi minutieusement ses peintures que
ses modèles ; installant, combinant, cherchant un équilibre de tension
– en particulier pour ses natures mortes. Il peignait sur des toiles
sombres, préparées à la terre de sienne brûlée, et remontait patiemment sa
peinture vers les clairs, les faisant suinter couche après couche de la masse
du fond ; ce alors qu’il intensifiait les ombres par des jus froids,
verdâtres, plus foncés que le fond. Les accents très clairs comme les traits
sombres s’inscrivent comme en éclat, d’un coup de pinceau rapide –
« écume jetée », écrit Diderot, op.
cit. Cette lente préparation devait culminer en des instants singuliers de
rapidité.
55. « Et
pourtant elle se meut », phrase attribuée à Gallilée sortant de sa
rétractation (1633) – dont il reste utile de rappeler que la condamnation
prononcée par l’inquisation ne fut pas motivée par le fait qu’il émit l’hypothèse
d’une terre en rotation autour du soleil, mais bien par son incapacité à la
prouver scientifiquement.
56. Titre
du texte manifeste de Barnett Newman, publié en 1948.
57. Sur ce
public, voir les photographies de Thomas Struth, Museum, série éloquante.
58.
Extraits de The Sublime is now, texte
manifeste de Barnett Newman
59.
Traduction des extraits tels que publiés dans Art en théorie 1900-1990, une anthlogie par Charles Harrisson et Paul
Wood, trad. Baudoin, pp. 634-636.
60. Aphorisme
verbal de Franck Stella, 1964, exemplifiant la position radicale de l’art
minimal.
61. Maurice
Blanchot, Thomas l’obscur, roman (1941),
pp. 38-39.
62. Pour
reprendre la prémisse du Capital, de
Karl Marx (première phrase, 1.1.1, vol. 1, p. 561), sa relecture
“situationniste” par Debord dans La
Société du spectacle (première phrase, 1, p. 10) et l’actualiser, comptant
le gigantesque déploiement des échanges de signes, d’informations et d’images (flux
instagram, pinterest, – GAFAMA – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft,
Ali Baba, etc.) dont, au premier temps d’écriture de cette étude (1993), personne
ne pouvait imaginer l’avènement. Ancrées à ce temps passé, ces textes, repris
et complétés par bribes jusqu’en 2017 – avec un creux de presque vingt
ans pendant lequel j’ai œuvré dans l’enseignement en communication numérique
– ne peuvent aborder ici l’actuel paradigme des échanges numériques, en
particulier d’images – “photographies” et “vidéos” réalisées via Smartphone par tous et pour personne,
qui hors s’accumuler en consultation compulsive et immédiatement “disparaître”
sous le fux de nouvelles images – échanges, sans propos, sans sens, sans
communication y compris lorsque quelque récepteur affiche (et est-ce vraiment à
l’intention de l’émetteur ?) quelques commentaires tout aussi vides. Les
points ici soulevés posent les questions sous un tel écart d’angle que des
développements trouveront plus aisément place dans d’autres études ou essais, à
venir. Il m’apparaît de même que les images que je produis depuis ma reprise
d’une activité visuelle en 2014 sont tout autant une re–prise des
préoccupations de 1993 qu’une réponse à la situation actuelle, réponse qui
prend la forme d’images de “rien” ou presque-rien, d’images qui sont
d’a–réponse, d’images qui sont des questions sans réponse possible (dans
le sens où Blanchot le postule dans La
question la plus profonde in « L’Entretien infini », pp. 12-34).
63.
Jean-François Lyotard, Le Sublime et
l’avant-garde, in « L’Inhumain, causeries sur le temps ». Les
autres citations de cette ouvrage seront référées aux titres de chapitre, et
non à la pagination.
64. Paul
Celan, phases préparatoires à Der
Meridian, in « Le Méridien et autres proses », p. 68 et p. 105.
65. Hegel, Esthétique, Introduction, Chap. 1,
Section 1, § 3.
66.
Blanchot, L’Espace littéraire, pp.
284-285. A noter que la jeune génération contemporaine à Newman va bel et bien,
du Black Mountain College au pop art,
faire entrer l’art dans la vie, le confondre à la vie personnelle, sociale,
politique, économique ; moi-même faisant par ailleurs ce choix de 1997 à
2014, via l’enseignement et la création d’une école en communication numérique
interactive ; mais c’est un choix qui peut être dit an–artistique.
67. Jean-François
Lyotard, L’Instant, Newman (sur le
sublime de Burke), in « L’Inhumain ».
68. Idem, Quelque chose comme : “communication…
sans communication” (sur le sublime de Kant)
69. Idem, Représentation, présentation, imprésentable.
70. Idem, Après le sublime, état de l’esthétique.
71.
Blanchot, L’Espace littéraire, p.
292.
72. Paul
Evdokimov, L’Art de l’icône, théologie de
la beauté, p. 151, citation complète : « Dans les maisons des fidèles,
l’icône est placée haut et au point dominant de la pièce : elle guide le regard
vers le haut, vers le Très-haut et vers l’unique nécessaire. La contemplation
orante traverse, pour ainsi dire, l’icône et ne s’arrête qu’au contenu vivant
qu’elle traduit. Dans sa fonction liturgique, symbiose du sens et de la
présence, elle sacre les temps et les lieux ; d’une habitation neutre elle
fait une “église domestique”, de la vie d’un fidèle, une vie orante, liturgie
intériorisée et continuée. Un visiteur, en entrant, s’incline devant l’icône,
recueille le regard de Dieu et ensuite salue le maître de la maison. On
commence par rendre honneur à Dieu, et les honneurs rendus aux hommes viennent
après. Point de mire, jamais décoration, l’icône centre toute la demeure sur le
rayonnement de l’au-delà. »
73. Hegel, La Philosophie de l‘esprit, in
« Encyclopédie des sciences philosophiques III », p. 462.
74. Ludwig
Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 6.522 & 7.
75. Ludwig Wittgenstein, Remarques
philosophiques, p. 84.
76. Malevitch, à propos de
son Quadrangle blanc (Carré blanc sur fond blanc) : «
J’ai troué l’abat-jour bleu des limitations colorées, je suis sorti dans le
blanc, voguez à ma suite, camarades aviateurs, dans l’abîme, j’ai établi les
sémaphores du Suprématisme. J’ai vaincu la doublure du ciel coloré après
l’avoir arrachée, j’ai mis les couleurs dans le sac ainsi formé et j’y ai fait
un nœud. Voguez ! L’abîme libre blanc, l’infini sont devant vous. »
77. Emmanuel
Kant, Critique de la faculté de juger, §
25.
78. Quadrangle, ce pourquoi il est erroné de nommer cette
œuvre et ses similaires Carré noir sur
fond blanc, Carré rouge sur fond blanc, Carré blanc sur fond blanc.
79. Exode 3.14.
80. Heidegger, Nietzsche I,
p. 104.
81. Cette citation et les suivantes, placées ensuite en
retrait et sans guillemets, sont issues de l’article La Banalité de la saturation, in « Le Visible et le
révélé » de Jean-Luc Marion, pp. 154-156, 172-176 et 179-180.
82. Un urinoir signé à l’encre noir, “renversé” par la
position de la signature, R. Mutt 1917,
proposé anonymement à exposition lors de la première manifestation des artistes
indépendants de New York, société, qui postula que “tout objet d’art adressé
serait exposé” et présidée par Marcel Duchamp. L’objet Urinoir fut refusé sous un simple prétexte de mauvais étiquetage
– le comité s’écharpant sur le statut artistique ou non de la
proposition, ne parvenant pas à déterminer “en quoi il ne serait pas de l’art”
tout en lui déniant le statut artistique – ce sous le regard discret de
son président. Duchamp, qui se cachait derrière R. Mutt, souriait sans doute
intérieurement devant la suite qu’il préparait à son coup : faire défendre
par une journaliste prête-nom le statut artistique de l’Urinoir dans la revue Dada The
Blind Man, attribuant à l’objet le statut de Bouddha de la salle de bain ; et le faire photographier par
l’artiste Stieglitz dans sa galerie d’art, sous le titre de Fountain.
83. Toutes
les citations encartées par des guillemets anglais (soit : “ ”) dans
celles de Marion (La Banalité
de la saturation) et dans leur retrait, sont de Marcel
Duchamp, tirées du film de Jean-Marie Droz,
Jeu d’échec avec Marcel Duchamp. Les hésitations de l’oralité,
signifiantes, sont conservées et identifiées par des italiques.
84. Hors
exceptions notifiées, toutes les citations encartées par des guillemets
français (soit : « ») dans celles de Marion (La Banalité de la saturation) et dans leur retrait, sont de Marcel Duchamp,
tirées de l’interview de Georges Charbonnier,
Entretiens avec Marcel Duchamp. Les hésitations de l’oralité, signifiantes,
sont conservées et identifiées par des italiques.
85. Dans
une perspective (post –) phénoménologique (et catholique, fait éludé par
l’usage que je puis en faire), Marion entend le “phénomène saturé” comme
un équivalent (amplifié et déplacé) du sublime kantien.
86. Marcel
Duchamp, “rasoir d’Ockham” en sa Lettre à
André sur Michel Carrouges, in « Duchamp de signe », p. 235. Voir
le ready-made Porte qui ne s’ouvre ni
se ferme, au 11, rue Larrey.
87.
« Quand | la fumée du tabac | sent aussi | de la bouche | qui l’exhale,|
les deux odeurs | s’épousent par | infra-mince | Marcel Duchamp », Infra-mince,
in « Duchamp du signe, p. 274.
88.
Duchamp, Alpha (B/CRI) tique –
regardeurs, in « Duchamp du signe », p. 247.
89. Le
titre et l’intention, voire le programme d’Etant
donnés s’établit très tôt, à conception de La Mariée, et est ad minima
posé en 1934, dans La Boîte verte, préface et avertissement, in « Duchamp du signe », p. 43.
90.
« Sorte de sous-titre | Retard en verre | Employer “retard” à la place de
tableau ou peinture ; tableau sur verre devient retard en verre –
mais retard en verre ne veut pas dire tableau sur verre. –
[…] –
en faire un retard dans tout le général possible, pas tant dans les différents
sens dans lesquels retard peut être pris, mais plutôt dans leur réunion
indécise. “Retard” – un retard en verre, comme on dirait un poème en
prose ou un crachoir en argent. » Duchamp, La Boîte verte, notes marginales, in « Duchamp du
signe », p. 41.
91. Lettre (sans
doute adressée en français), publiée en traduction anglaise dans Francis M.
Naumann, Affectueusement, Marcel: Ten
Letters from Marcel Duchamp to Suzanne Duchamp and Jean Crotti, in « Archives of American Art Journal, Vol. 22, No. 4 », pp. 16-17, que
je re–traduis ici en français (si de fait le sens est conservé, les mots
exacts sont peut-être trahis).
92. En
synergologie, le geste est interprété comme affirmation consciente d’un « je
m’en fiche réellement, je ne veux ni le voir ni le considérer ».
Source : Schaller Catherine, Dre en histoire de l’art et
synergologue.
93. Marcel
Duchamp est, ou a été, sans aucun doute, témoin d’un événement – ou
d’événements, dont la nature, par contre, reste dans le non-dit ou le non-dicible.
Ad minima, cet événement peut-être
considéré comme l’apparition du phénomène “art”, mais sans doute est-ce plus. Sans
aller aussi loin que l’hypothèse d’une expérience de mort imminente, formulée
par Alain Botton en seconde partie de Marcel
Duchamp par lui-même (ou presque), quelque événement “matrice” de l’œuvre a
eu lieu. Peut-être est-ce la « Révélation de Munich », selon le seul
élément que Duchamp en donne, à savoir son nom. Impossible de savoir ce qu’a
été cette révélation ; hors que Duchamp y séjourna chez Max
Bergmann, visita de nombreux musées, fit quelque peintures (dont les premières Mariées) et fréquenta peut-être des
cercles occultistes. Cette « révélation du symbolique » (de Duve in Résonnances du readymade et Cousu de fil d’or, empruntant le concept
à Lacan) est entre-lisible dans les notes (surtout les premières) de La Boîte verte, in « Duchamp du
signe » pp. 41-101 :
« La Mariée mise à nu par ses célibataires, même :
pour écarter le tout fait, en série, du
tout trouvé. – L’écart est une opération. » (p. 41)
« 1912 | La machine à 5 cœur, l’enfant pur, de nickel
et de platine, doivent dominer la route Jura-Paris. | D’un côté, le chef des 5
nus sera en avant des 4 autres vers
cette route Jura-Paris. De l’autre côté, l’enfant-phare sera l’instrument
vainqueur de cette route Jura-Paris. | Cet enfant-phare pourra, graphiquement,
être une comète, qui aurait sa queue en avant, cette queue étant appendice de
l’enfant-phare, appendice qui absorbe en l’émiettant (en poussière d’or, graphiquement,
cette route Jura-Paris. | La route Jura-Paris, devant être infinie seulement
humainement, ne perdra rien de son caractère d’infinité en trouvant un terme
d’un côté dans le chef des 5 nus de l’autre dans l’enfant-phare. | Le terme
“indéfini” me semble plus juste qu’infini. Elle aura un commencement dans le
chef des 5 nus, et n’aura pas de fin dans l’enfant-phare. | […] | Mais à son
commencement […] elle sera très finie en largeur, épaisseur, etc., pour petit à
petit devenir sans forme topographique, en se rapprochant de cette droite
idéale qui trouve son trou vers l’infini dans l’enfant-phare. » (pp.
41-42)
« Préface | Etant donnés : 1° la chute d’eau, 2°
le gaz d’éclairage, | nous déterminerons les conditions du Repos instantané (ou
apparence allégorique) d’une succession (d’un ensemble) de faits divers
semblant se nécessiter l’un l’autre par des lois, pour isoler le signe de la concordance entre, d’une part, ce Repos […] et, d’autre part, un choix de Possibilités […] | Pour ce
repos instantané = faire entrer l’expression extra-rapide. On déterminera les conditions de
meilleure exposition du Repos extra-rapide ( = apparence allégorique) d’un
ensemble. … etc. | rien Peut-être. » (p. 43)
« Avertissement | Etant donnés (dans l’obscurité) 1°
la chute d’eau | Soit, donnés 2° le gaz d’éclairage, dans l’obscurité, on déterminera (les conditions de) l’exposition
du Repos extra-rapide ( = apparence allégorique) de plusieurs collisions
semblant se succéder rigoureusement chacune à chacune par des lois, pour isoler le signe de la concordance entre
cette exposition extra-rapide […] d’une
part et le choix des possibilités légitimées par ces lois d’autre part. » (pp. 43-44)
« Comparaison algébrique | a/b, a étant
l’exposition ; b [étant] les possibilités | le rapport a/b est tout entier
non pas dans un nombre […] mais dans le signe (a/b) qui sépare a et b […] (signe de la concordance ou plutôt de.
… ? …. chercher.) | […] en laissant traîner derrière soi une
teinture de persistance dans la
situation.[…] » (p. 44)
« […] En général, le tableau est l’apparition d’une
apparence. (voir explication). […] » (p. 45)
« […] – Phénomène
ou principe de densité oscillante […] » (p. 46)
« […] Perdre la possibilité de reconnaître 2 choses semblables
– 2 couleurs, 2 dentelles, 2 chapeaux, 2 formes quelconques. Arriver à
l’impossibilité de mémoire visuelle suffisante pour transporter d’un semblable
à l’autre l’empreinte en mémoire. | Même possibilité avec des sons ; des
cervellités. » (p. 47)
« […] Peut-être se servir de cela pour l’éclaboussement. » (p. 51)
« (Epanouissement) ABC | En faire une Inscription | (titre). | Inscription
mouvante […] | […] | Figurer sculpturalement cette inscription en mouvement […] | […] | (Pour
l’“Inscription du haut” | épanouissement. 1914 » (pp. 57-58)
« Mariée | […] | Toute l’importance graphique est pour
cet épanouissement cinématique. | […] Cet épanouissent cinématique est la
partie la p. importante du tableau […]. Il est, en général, l’auréole de la
mariée, l’ensemble de ses vibrations splendides. […] Dans cet épanouissement,
la mariée se présente nue sous 2 apparences [vue par les célibataires, imaginée
par elle-même]. De l’accouplement de ces 2 apparences […] de leur collision
dépend tout l’épanouissement […] | […] | […] Des 2 développements graphique
obtenus, trouver leur conciliation, qui soit “l’épanouissement” sans
distinction de cause. » (pp. 62-63)
« Ventilation : | Partir d’un courant d’air intérieur. » (p. 68)
« Le gaz d’éclairage | […] | De leur étourdissement (provisoire), de leur perte de connaissance de situation
[…]. » (p.74)
« Tableaux
d’oculiste – | Eblouissement de l’éclaboussure par les tableaux
d’oculiste. | Sculpture de goutte (points) que forme l’éclaboussure après avoir
été éblouie à travers les tableaux oculistes […] » (pp. 92-93)
« Couleur | […] 1° son apparence = impression
rétinienne (et autres conséquences sensorielles) | 2° son apparition.
[…] » (p.98)
« Eclairage intérieur | | […] | Déterminer les effets
lumineux (ombres et lumières) d’une source intérieure, c’est à dire que chaque
matière […] est douée d’une “phosphorescence”
( ?) et s’illumine […] » (pp. 100-101)
« Possible | La
figuration d’un possible. | (pas comme contraire d’impossible | ni comme
relatif à probable | ni comme subordonné à vraisemblable) | Le possible est seulement | un “mordant” physique (genre vitriol) |
brûlant toute esthétique ou callistique. » (p. 104)
De l’écart comme figuration à la figuration d’un possible
brûlant tout, passant par l’étrange enfant-phare, ligne-trou, signe de
concordance, obscurité exposée, phénomène de densité oscillante, éclaboussement
et épanouissement, apparition de l’apparence, éblouissement de l’apparition,
étourdissement, perte de connaissance de la situation, éclairage intérieur, etc.
Duchamp pose des symptômes troublants et inexpliqués (le « voir
explication » ne se développe pas), parfois hésitant entre faire ou
non : « rien Peut-être. » qui, s’ils ne sont expériences
mystiques ou oculistes, sont à tout le moins très proche des phénomènes de
saturation levés par Jean-Luc Marion ou du sublime Kantien ; voire
relèvent presque de l’expérience phénoménologique (Kant, Hegel, Husserl
auraient-ils pu être un acquis munichois de 1912 ?). Ou Mallarmé, lu d’une
lecture intime, aurait ouvert une voie (telle qu’ensuite Blanchot la met à
jour-obscur).
Tout ceci reste à développer – oui Peut-être –
en l’hypothèse que la recherche de Duchamp tient du sublime, de
l’a–perception et de l’a–conception développés dans ces études.
94. Duchamp, A l’infinitif
« Boîte blanche », in « Duchamp du signe », p. 105.
95. LeWitt, cité par Kosuth, Art after Philosophy, in « Studio International, October, 1969 ».
96. Shakespeare, Hamlet, act 3, scene 2 ; act 5, scene 2 & act 2, scene 2.
97.
« A la fin de… 1919, je repartis pour l’Amérique et, voulant rapporter un
cadeau à mes amis les Arensberg, je demandai à un pharmacien parisien de vider
une ampoule de verre pleine de sérum et de la ressouder. Ceci est la précieuse
ampoule de 50 centimètres cubes d’Air de
Paris que je rapportai aux Arensberg en 1919. » Duchamp, A propos de moi-même, in « Duchamp
du signe », p. 227.
98. « Tableaux
d’oculiste – | Eblouissement
de l’éclaboussure | Sculpture de gouttes (points) que forme l’éclaboussure à
travers les tableaux oculistes, chaque goutte servant de point et renvoyée
miroriquement dans la partie haute du verre […] | Renvoi miroirique –
Chaque goutte passera […] », Duchamp, La
Boîte verte, in « Duchamp du signe », pp. 92-93. « Faire une
armoire à glace | Faire cette armoire à glace pour le tain », Duchamp, La Boîte de 1914, in « Duchamp du
signe », p. 38. « Argenter (comme un miroir) une partie du
fracas-éclaboussement », La Boîte
verte, in « Duchamp du signe », p. 118. « Les hommes au
miroir | Souvent le miroir les emprisonne et les retient fermement. Ils se
tiennent devant lui, fascinés. Ils sont absorbés, séparés de la réalité […] Le
miroir les regarde […] | Rrose Sélavy », Duchamp, Texticules, in « Duchamp du signe », pp. 270-271. « […]
Ils auraient été comme enveloppés […] d’un miroir qui leur aurait renvoyé leur
propre complexité au point de les halluciner assez onaniquement. » La Boîte verte, in « Duchamp du
signe », p. 76. Le renvoi miroirique a, en outre, été mis en œuvre par Dan
Graham, dans plusieurs de ses installations, dont Two
Adjacent Pavilions.
99. Duchamp, dans l’interview de Georges Charbonnier,
Entretiens avec Marcel Duchamp.
100.
Idem : « Cette imprécision, cette indécision, et quand même…
ça ne fait pas non sens… ce n’est même pas du non sens, mais ça donne une
direction… […] très inquiétante, donc vous voyez c’est c’est une veine qui m’a
com’ que j’aimais bien exploiter ou que j’
j’essayais d’exploiter et… je le fais dans ce titre là ou dans la peinture
elle-même ou dans la l’exécution du
Grand verre c’était la même idée dans tout ce qui composait ce verre. C’est de d’obtenir des effets qui partent en
tangentes, d’une tradition ou d’une acceptation normale des choses comme “la
fenêtre se ferme” le “la porte
s’ouvre” et cætera qui sont des choses trop connues depuis
trop longtemps et dont on aurai jamais pu parler, comprenez-vous ? Après
tout un tableau est est un diagramme,
d’une idée. »
101. Idem.
102. Idem : « “Nu vite” évidemment c’est très
simple, c’est un plaisir à jouer avec les mots. Quoi… que, vous savez ce que
j’en pense des mots, mais je dès que
vous y ajouter de la poésie ou du moins que vous transformez le mot de
communication en mot poétique, alors là
j’accepte parce que le mot devient comme une autre couleur, si vous voulez et
non pas une communication. Je n’ai pas inventé le mot “vite” puisqu’à ce moment
les il existait comme adjectif :
on disait que Monsieur untel qui avait fait la course de Paris Roubaix était
« vite » ; c’était une nouveauté sémantique à ce moment-là,
comprenez-vous ? Donc je m’en suis servi dans avec mes « nus », comprenez-vous , c’est c’était donc une application et
alors, avec l’idée aussi… d’ et très
importante d’introduire… l’ le rire
dans le sens bon du mot, pas le rire grossier ou la la mauvai’ l’humour… d’
d’une certaine qualité encore
difficile à… à exprimer, mais… s, je le considérai que tout le passé de la
tradition sauf Rabe-lais ! et Ja-rry ! était fait de gens sérieux…
qui considéraient que l’ la vie était
une chose sérieuse, qu’il fallait produire des choses sérieuses pour que la
postérité sérieuse comprenne ce que tous t’
ces gens sérieux de cette époque avaient fait. Et ça j’ai voulu m’en débarrasser
aussi : donc j’ai mis le mot “nu vite” qui n’était plus sérieux du tout,
il s’agissait, même pas d’en rire mais de se demander si je me m’ moquais du monde. »
103. Cette
citation et les suivantes, placées ensuite en retrait et sans guillemets, sont
tirées de Maurice Blanchot, Thomas
l’obscur, roman, pp. 89-90 et 94-95.
104. Dans l’interview
de Georges Charbonnier, Entretiens avec
Marcel Duchamp.
105. Idem.
106. Dernière scène de Mort
à Venise, de Visconti, qui fait comme répons à celle de Théorème, de Pasolini.
107. Wittgenstein, Remarques
sur les couleurs, (III, 184).
108. Idem
109. Idem (III, 145). Citons aussi : « Pourquoi un
blanc transparent n’est-il pas possible ? – Peint un corps rouge
transparent, et ensuite remplace le rouge par le blanc ! Le noir et le blanc
sont déjà pour quelque chose dans la transparence d’une couleur. Si tu
remplaces le rouge par le blanc, alors l’impression de la transparence ne se
produit plus. » (III, 24) ; voir aussi les Remarques (I, 46), (III, 24), (III, 195).
110. Marcel Duchamp, Dictionnaires
et atlas, in « Duchamp du signe », p. 110.
111. On trouve dans La
Boîte verte, in « Duchamp du
signe » de nombreux appels que fait Duchamp de ce rapport obligé
transparence-opacité. Ainsi :
« […] dans
l’obscurité, on déterminera (les conditions de) l’exposition
extra-rapide » (p. 43)
« L’intérieur et
l’extérieur […] peuvent recevoir une semblable identification […] » (p.
45)
« En général, le tableau et l’apparition d’une
apparence. | Mettre toute la mariée sous globe, ou dans une cage
transparente. » (p. 45)
« Faire un
ready-made avec une boîte enfermant quelque chose irreconnaissable au son et
souder la boîte [ce sera A bruit secret]
(p. 49)
« Ombre portée de 2, 3, 4, Readymades “rapprochés”. […] Prendre ces “devenus”
et en faire un relevé sur calque […]. » (p. 50)
« Tableau ou sculpture | Récipient plat en verre
– (recevant) toutes sortes de liquides colorés, morceaux de bois, de fer,
réactions chimiques. Agiter le récipient, et regarder par transparence. »
(p. 51)
« Hyposulfiter […] [ainsi] se superposant […] mais
n’imprimant que l’essentiel sans fond (le fond transparent du verre. […]
Peut-être se servir d’un moindre transparent (verre dépoli ou papier huilé ou
verni sur verre) permettant une opacité provisoire […]. » (p. 58)
« […] La représentation matérielle ne sera qu’un exemple de chacune de ces formes principales libres. (Un exemple
sans valeur représentative, mais permettant
le plus ou le moins). » (p. 67)
« Partir d’un courant
d’air intérieur. » (p. 68)
« Le Pendu femelle est la forme en perspective ordinaire d’un Pendu femelle dont on pourrait
peut-être essayer de retrouver la vraie
forme. » (p. 69)
« Moules mâliques (Mâlics ( ?)) | Par matrice
d’éros, en entend […] 8 formes mâliques […] | Les moulages du gaz ainsi obtenues entendraient les litanies […] sans
qu’ils pourront jamais dépasser le
Masque = Ils auraient été comme enveloppés […] » (p. 76)
« Elever de la poussière sur des verres. Poussière de 4
mois, de 6 mois qu’on enferme ensuite hermétiquement = Transparence |
Différences – chercher. | Pour les tamis dans le verre – laisser
tomber la poussière sur cette partie, une poussière de 3 ou 4 mois est essuyer
bien autour de façon à ce que la poussière soit une sorte de couleur (pastel
transparent). Emploi du mica. | Chercher aussi plusieurs couches de couleurs
transparentes (avec du vernis probablement) l’une au-dessus de l’autre, le tout
sur verre. – | Mentionner la qualité de poussière à l’envers soit comme nom du métal ou autre. » (pp.
78-79)
« Les tamis
de l’appareil célibataire sont une image
inversée de la porosité. »
(p. 79)
« Sculpture de gouttes (points) […]. Les gouttes
miroiriques, pas les gouttes mêmes, mais leur image passent entre les 2 états
de la même figure | (Peut-être employer des prismes collés derrière le verre
pour obtenir l’effet cherché). » (p. 93)
« Couleur | Soit
un objet en chocolat. | 1° son apparence = impression rétinienne ( et
autres conséquences sensorielles) | 2° son apparition. | Le moule d’un objet en chocolat est l’apparition négative du plan […] générateur […] : dans le
passage de l’apparition (moule) à l’apparence, le plan, composé d’éléments de lumière de type chocolat détermine la masse chocolat appâtent par teinture physique. | L’apparition négative (déterminée pour la forme colorée conventionnellement
par la perspective linéaire […]) […] de même cette apparition négative, pour le phénomène de teinture physique, est déterminée par source de lumière devenant
dans l’objet apparent masse éclairée
(couleurs natives = apparition en
négatif des couleurs apparentes de la
matière des objets.) » (pp. 99-100)
« Elevage des couleurs | En serre – (sur plaque
de verre, couleurs vues par transparence. » (p. 100)
« […] 9 trous | ombres portées formées par les éclaboussures
| venant d’en bas comme certains jets d’eau | accrochent des formes dans leur
transparence. » (p. 103)
Ce rapport transparence-opacité se poursuit ailleurs (y
compris dans les ready-made et leur jeu de couplage-opposition – un
ready-made transparent, un ready-made opaque), ainsi dans la Boîte blanche :
« Se servir du verre dépoli derrière lequel on applique
du papier noir mat (effet argent) [vers Fresh
widow] […] Avoir une pièce toute en glace […] » (p. 108)
« […] Verre | Jus transparent incolore | […] »
(pp. 114-115)
Voir aussi : « Nouvelle référence au verre »
(p. 118) et « Apparence et apparition », redéveloppées pp. 120-122.
112. Blanchot, Thomas
l’obscur, roman, p. 208 et p. 216.
113. Blanchot, L’Espace
littéraire, p. 14.
114. Idem, p. 15.
115. Duchamp, Entretiens, op. cit.
116. Kosuth, Art after
philosophy.
117. Refusant à
l’art toute analyse synthétique, Kosuth ne peut qu’occulter cette question :
si “contexte de l’art il y a”, l’objet, pour y entrer, doit y être accepté (ou
refusé, auquel cas il reste, sous sa définition, objet) ou en forcer l’entrée
– ce que Kosuth tend à penser sous l’aspect d’un objet qui ajoute à la
signification admise de l’art de nouvelle(s) signification(s). Ce qui est
impensé est que pour Kosuth cela aille de soit ! Hors il faut bien que
quelque chose soit “prêt” dans l’époque, que l’objet corresponde aux attentes
ou au “goût” d’une époque, pour qu’il soit accepté – même faisant une
entrée forcée (ou au contraire refusé – avec parfois scandale ;
refus ou scandale qui ne prédise nullement d’une plus tardive ou autre
acceptation, à une autre époque ou en un autre lieu.)
Ainsi,
comme l’a montré Benjamin Buchloh, Conceptual Art 1962–1969, la
consécration de l’art conceptuel par le contexte de l’art est concomitant de la
montée d’une société de gestion, pour laquelle ordonner, étiqueter, classer et
définir sont maîtres mots – ne produisant rien, mais se considérant management
nécessaire au contrôle des ressources, de la production et des échanges –
en institution “critique” de l’institution – et qui trouva dans les
formes “définitives”, “déclaratives” et “neutralisées” de l’art conceptuel son
esthétique.
A noter que Kosuth tombe sous une
aporie, issue d’une citation du philosophe analytique G.H. Von Wright, que
lui-même invoque : “The subject matter of conceptual investigations is the
meaning of certain words and expressions
– and not the things and states of affairs themselves about which we talk.” Hors le texte complet de Kosuth
cherche à parler de l’art lui-même, et ne fait que le ramener non à
ce qu’il est mais a ce qu’il signifie – d’où sa définition,
tautologiquement vide, finale : “art is the definition of art” ;
preuve que sa démarche – issue de la philosophie analytique – n’atteint pas le but qu’elle s’était
fixée ; et que, même étant totalement correcte, vraie et juste, elle
échoue.
118. Judd, cité par Kosuth, Art after philosophy.
119. Blanchot, L’Espace
littéraire, p. 19.
120. Idem, p. 246, citant une lettre de Rilke, à Clara Rilke.
121. Duchamp, Entretiens, op. cit.
122. Blanchot, L’Espace
littéraire, p. 122.
123. En référence à l’agence “artistique” de Philippe Thomas, Les Ready-made appartiennent à tout le
monde.
124.
Textes édités dans Igitur,
Divagations, Un Coup de dés, op. cit. , pp. 247-288.
125. Blanchot,
L’Espace littéraire, p. 294.
126. Idem, pp. 294-295.
127. Idem, pp. 347-348.
128. La Vie est un
songe, tragi-comédie de Calderon de la Barca, Macbeth, act 5, scene 5, de Shakespeare.
129. Blanchot, L’Espace
littéraire, pp. 295-296 et 300.
130. Idem, p. 300.
131. Idem, p. 303.
132. Idem, dans les annexes, L’Itinéraire de Hölderlin, p. 372.
133. Duchamp, Entretiens, op. cit.
134. Blanchot,
L’Espace littéraire, pp.
269-270.
135. Idem, p. 328.
136. Voir Blanchot, La
Question la plus ouverte, in « L’Entretien infini », pp. 14-39.
137. Blanchot,
L’Espace littéraire, pp.
330-332.
138. Duchamp, Entretiens, op. cit. A noter que sur la dernière partie
de la remarque : « […] il y aura un déchet fantastique, dans
une production comme la nôtre aujourd’hui, […] les greniers ne seront jamais
assez grands pour garder tout […] », nos sociétés mondialisées du
spectacle consumériste a, d’une certaine manière répondu : on ne compte
plus les succursales déterritorialisées de musées (Guggenheim Bilbao, Louvre
Abu Dhabi, etc.) ; ni la vogue des fondations privées aux architectures
manifestes du pouvoir spéculatif (Vuitton à Paris) ; ni les
agrandissements de musées existants (Tate Modern de Londres, MoMA de New York,
MoCA de Los Angeles, Kunsthaus de Bâle – autant d’annexes souvent liées
au sous-sol au bâtiment historique, qui se présentent comme de gigantesques mausolées
enterrant des pièces “contemporaines” aussi monumentales que mortes.
139. Blanchot,
L’Espace littéraire, pp. 328.
140. Marcel Duchamp, Adress
to a symposium at the Philadelphia Museum College of Art, March 1961.
Translated by Helen Meakins. First published in the Duchamp issue of Studio international, 1975)
141. Peut-être est-ce le cas de Warhol, Hirst, Koons, les Camouflages, comme disparition de l’être dans son individualité de
l’un, étant revers de l’exhibitionnisme des Divided
animalier de l’autre, disparition de l’être dans son humanité, amplifiée
par la gratuité des Balloons du
troisième, disparition de l’être dans sa choséité (un jour, peut-être, à
réfléchir, si “ça en vaut la peine”).
142. Vide d’être sans faire non-être compris comme néant,
tel que l’entend Maurice Blanchot dans L’Expérience
limite, in « L’Entretien Infini », p. 226 : « Heidegger
[…] suggérait que nous serions bien inspirés en écrivant désormais le mot être
et le mot néant que barrés par une croix de Saint-André : être [barré],
néant [barré] » ; ce qui nous r–approche des premières lignes
du Tao Te King : « Le Sens que l’on peut exprimer | n’est pas
le sens éternel. | Le nom que l’on peut proférer n’est pas le Nom éternel. | J’appelle “Non-être” le
commencement de Ciel et Terre”. | J’appelle “Etre” la Mère des êtres
individuels. | Se diriger vers le Non-être, | amène à contempler l’Essence
merveilleuse, | se diriger vers l’Etre, | à contempler les limitations
spatiales. | Tous deux sont originellement un | et par le nom seul différent. |
Dans cette Unité cet Un est mystère. | Mystère des mystères | est la porte par
où surgissent toutes merveilles. | […] | […] Car Etre et Non-Etre mutuellement
s’engendrent […] » (I, version Wilhelm et Perrot, pp. 51-52).
En ce sens, dans le zéro qu’est “O”, le contour du cercle
est Etre, qui appelle à contempler les limitations spatiales, et fait être
l’intérieur de ce cercle comme Non-être, qui appelle à contempler l’essence
même de l’Etre – sans limitation spatiale.
143. Les jonctions communicantes, aussi appelées jonctions gap ou >macula communicans ou nexus ou
jonctions lacunaires ou encore jonctions perméables, sont des jonctions
intercellulaires mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines.
Chez l'être humain, les jonctions communicantes se situent principalement dans
le système nerveux central (wikipedia, article “jonction communicantes”)
– une abondante littérature scientifique étant disponible sur le réseau
internet (chercher à travers les mots clefs “jonctions gap”)
sur ce sujet, nous ne développerons pas ici ce point, ni les ressources
bibliographiques utiles.
Contentons-nous pour l’instant de noter que rejetant la
philosophie analytique – qui rejette la “continentale” comme idéaliste et
métaphysique, soit le cours suivi jusqu’ici – nous ne tombons pas dans
cet idéalité méta- mais bien sur la plus scientifique des disciplines : la
physique du cerveau, à savoir la science neurocognitive. Ainsi si Kant qui écrit
de l’effet du sublime qu’il attire et repousse toujours alternativement l’esprit dans une satisfaction qui recèle un plaisir
négatif, la science peut au moins aujourd’hui observer, décrire et analyser
– si ce n’est le sublime, au moins sont effet sur l’esprit.
144. Terme repris de Benjamin Delmotte, Le visible et l’intouchable.
145. Christo, dont les Wrapped
trees de la fondation Beyeler, 1997
146. Autres aphorismes renversants de cet ami très cher, à
l’école supérieure d’art visuel et après, devenu expert diamantaire, soit de la
transparence, depuis parti pour Anvers, Bombay et Ventiane et perdu de vue,
venu qu’il était de Chine :
« Je pars demain pour New York, en
extrême-occident » ; ou, lui, arrêt de bus Place Neuve, prenant le 10
qui le conduira à l’aéroport, puis de là à un séjour à Beijing, me dit :
« Bon voyage » et à mon air interloqué : « Moi, je reste où
je suis… pour moi, c’est toi qui bouges, t’éloignes » - ce qui rappelle bien entendu l’aphorisme
et dernier ready-made de Duchamp, sur sa tombe : « D’ailleurs, c’est
toujours les autres qui meurent ».
Lui, face à un jury qui examine son travail sous l’air de
“ça a déjà été fait” : « Monsieur, vous avez mangé hier ? donc
c’est fait. Mangerez-vous aujourd’hui ? » ; ou en réponse à un autre
lui demandant lesquelles de ses réalisations étaient celles du début et
lesquelles terminaient sa démarche : « Donc, tu peux me dire quand le
monde a commencé ; et quand il finira ! » ; ou éberluant un
autre, étonné de l’exotisme de son travail : « Plus la forêt est grande,
plus les oiseaux on trouve. »
Parfois provoquant, à un étudiant d’origine japonaise qui
lui disait chercher à produire un choc : « Je serai toi, je ferai
exploser une bombe atomique, ça c’est un œuvre qui choque », il a toujours
été révélateur : « Sur un papier, tu traces un trait, tu vois
quoi ? un trait ? Non : deux espaces » ; « Un
puzzle c’est des milliers de pièces pour une possibilité, un tangram c’est sept
pièces pour des millions de possibilités » ; « Les échecs, c’est
tactique, si tu cherches un jeu de stratégie, c’est le go » ;
« Le pays le plus communiste du monde, c’est la Chine, le pays où il y a
le plus d’entreprises marxistes au monde, c’est les Etats-Unis, et l’entreprise
la plus maoïste du monde, c’est Mac Donald’s. »
Nous cuisinions souvent chez lui, au milieu de la nuit, à la
flamme de gaz : « Tu vois cette casserole pleine d’eau ? on peut
faire quoi avec ? Cuire l’eau… ou éteindre le feu ! » ; ou,
dernière d’une série infinie, que j’arrête ici parce que j’ai particulièrement
appréciée : « Quand on est dans son bain, on ne sent pas qu’on est
mouillé. »
147. En réponse au Less is more d’Ad Rheinardt, Twelve Rules
for a New Academy.
148. Selon une règle très conceptuelle, le peintre a établi
une procédure en cas d’erreur : 1° si dans la suite progressive des
nombres il en oublie et va trop avant (tel 24, 25, 26, 36), il prendra ensuite
les nombres qui de l’erreur le ramène à la suite (du 36, inscrira 35, 34, 33…
etc. jusqu’au 26), puis reprendra son décompte normalement (26, 27, 28, etc.) :
2° si dans la suite progressive des nombres il s’oublie et vers l’arrière
régresse (tel 24, 25, 26, 16), il reprendra , sa suite depuis le nombre erroné
(16, 17, 18… 24, 25, 26, 27, etc.).
149. Expression de Roman Opalka pour qualifier son décompte devenu
blanc sur blanc.
150. Tao te king,
XLII, p. 95, puis LXIV, p. 117.
151. Shitao, Les
propos sur la peinture du moine Citrouille-amère, I, pp. 9-11.
152. Heidegger, Sein und Zeit, § 45, p. 235. Il est
renoncé à livrer traduction des citations, les chacune étant redéployée en
regard du travail d’Opalka.
153. Idem, § 65, p. 329.
154. Idem, p. 331.
155. Ainsi le décompte s’est achevé à 5607249 (le 6 août
2011), chiffre parfaitement visible et lisible porté à l’encre sur papier,
technique issue d’une autre règle que se fixait Opalka : si la plupart du
temps il décomptait en peinture, sur ces Fragments
de presque deux sur un mètre cinquante, lorsqu’il n’avait pas l’opportunité de
ce format d’atelier – en voyage, dans son lit, etc. – il
poursuivait son décompte sur des Carnets
de voyage de format A4.
156. Heidegger, Sein
und Zeit, § 66, p. 333.
157. Idem, § 72, p. 373.
158. Idem, § 78, p. 404.
159. Idem, p. 405.
160. Databilité exemplifiée par les Date Painting de Kawara, dont Dec.28.1977.
161. Heidegger, Sein
und Zeit, § 79, p. 406.
162. Idem, p. 410.
163. Pour les trois parties de citation telles que
découpées, idem, § 80, pp. 416-417.
164. Idem, pp. 412-416.
165. Idem, § 81, p. 422.
166. Voir le tout premier texte de cette étude, Point de vue.
167. Heidegger, Sein
und Zeit, § 81, p. 424.
168. Idem.
169. Idem, pp. 424-425.
170. On Kawara, op.
cit.
171. Heidegger, Sein und Zeit, § 83, p. 437.
172. Idem, § 78, pp. 404-405.
173. Idem, § 68, p. 338.
174. Idem,
§ 79, p. 410, à quoi peut être ajouté, pour couper cours à l’idée qu’Opalka a
perdu sa vie (son temps) à faire son œuvre : »Der Unentschlossene versteht
sich aus den in solchem Gegenwärtigen begegnenden und wechselnd sich
andrängenden nächsten Begebenheiten und Zu-fällen. An das
Besorgte vielgeschäftig sich verlierend, verliert der
Unentschlossene an es seine Zeit. Daher denn die für ihn
charakteristische Rede: “ich habe keine Zeit”. So wie der uneigentlich
Existierende ständig Zeit verliert und nie solche “hat”, so bleibt es die
Auszeichnung der Zeitlichkeit eigentlicher Existenz, daß sie in der
Entschlossenheit nie Zeit verliert und “immer Zeit hat”. Denn die Zeitlichkeit
der Entschlossenheit hat bezüglich ihrer Gegenwart den Charakter des Augenblicks.
Dessen eigentliches Gegenwärtigen der Situation hat selbst nicht die
Führung, sondern ist in der gewesenden Zukunft gehalten. Die
augenblickliche Existenz zeitigt sich als schicksalhaft ganze Erstrecktheit im
Sinne der eigentlichen, geschichtlichen Ständigkeit des Selbst.
Die dergestalt zeitliche Existenz hat “ständig” ihre Zeit für das,
was die Situation von ihr verlangt.« (idem).
"De cette
remarque peut être mise au jour l’exigence que demande de l’œuvre d’Opalka
(dans sa réalisation, dans sa contemplation) : la résolution – “Entschlossenheit” –, l’avoir
toujours le temps, étant avec lui dans ses limites, ne le perdant jamais (de
vue, de conscience) – “Entschlossenheit
nie Zeit verliert und immer Zeit hat” –, cette conscience du présent
qui n’est pas un maintenant mais un instant, et fait de l’existence celle de
chaque instant – “augenblickliche
Existenz” –, ce pour ce qui est requis par elle (existence ou œuvre)
– “von ihr verlangt”
– ; il s’agit bien d’une exigence inconditionnelle.
175. Idem, § 43, p. 204.
176. Idem, § 74, p. 384.
177. L’erreur peut demander l’excuse, la faute est coupable
et reste sans excuse demandée et, de fait, accordée. Qu’Heidegger ait vu la
temporalité authentique dans l’avènement d’un nouvel ordre social – le
nazisme – l’historialité advenir avec un homme – Hitler – et
le destin se mettre au jour – en hypostasiant le Dasein au peuple –, du moins pendant toute la période du Rectorat (1933-34), qu’il n’ait rien dit
des suites du régime et accueillit sa catastrophe comme “destin” (1934-45),
qu’ensuite il y ait fait l’impasse de toute explication, de toute
reconnaissance de la faute – ce qui en aurait fait une erreur -, ne considérant
pas même dans sa critique de la technique (1945-76) ce que le nazisme avait
d’usage totalitaire de la technique (mais autant que le communisme réel ou le
capitalisme libéral, tous systèmes de la technique que la seconde guerre
mondiale oppose) ; tout ceci invalide la personne d’Heidegger et certains
de ces textes, mais pas Sein und Zeit
qui date de 1927 et s’écrit hors connaissance de la montée progressive, et
d’abord locale, du national-socialisme. Si du texte on peut montrer comment
Heidegger a dérivé fatalement vers une libre acceptation du nazisme, on ne
saurait y lire les prémisses d’une telle pensée, inconnue de l’auteur lors de
la rédaction. Hors des débats idéologiques qui affectent, depuis, la réception
d’Heidegger, on pourra lire la remarquable enquête “policière”, à la fois
biographique et philosophique de Guillaume Payen, Martin Heidegger. On peut aussi comprendre que nombre de textes
critiques lient l’œuvre d’Opalka à la pensée de Levinas – se référer
ainsi à la victime paraissant plus propre que de renvoyer au coupable – reste
qu’il m’a paru intègre de renvoyer la comparaison à l’ouvrage qui fait souche
pour toute la phénoménologie et l’existentialisme du siècle. Et si, chez
Heidegger, on peut trouver le soupçon messianique d’entraîner chacun dans la
réalisation de sa pensée, gardons l’écart chez l’artiste : Opalka n’y
entraîne que lui-même, et nous, si nous le souhaitons, souvent d’ailleurs
l’espace d’un moment – ce moment où l’instant nous sera donné, fulgurance
dont nous pouvons, le moment d’après, à notre bon vouloir, nous libérer. Ainsi,
si comparaison il y a entre proposition artistique et pensée philosophique,
elle cesse à la liberté que nous conserve l’art, et dont la philosophie peut
nous priver, lorsqu’elle s’érige en système déjà ; ou pire, croit pouvoir
s’appliquer en politique.
178. Cinq
millions six cent sept mille deux cent quarante-neuf, en polonais, langue dans
laquelle Opalka comptait oralement (et parfois audio enregistrait) en peignant.
Il investissait de fait non seulement sa main, son oeil et sa mémoire, mais
aussi sa voix, sa respiration, l’entier de son souffle corporel, vivant la
longue litanie du décompte oral – qui prend son temps, vivant
intégralement ce temps pris (allant in fine jusqu’à en produire l’image de son
visage, de son regard se fatiguant, de ses traits se marquant, de sa peau
blanchissante, se photographiant devant son Détail
à chaque arrêt du travail, frontalité d’un face à face autant avec lui qu’avec
nous).
179. Atemwende de Paul Celan.
180. Ryonen
Genzô, texte calligraphié à gauche de son Cercle Enzo.
181. Et inister n’est pas l’étant – puisque c’est en
soi et non du dehors (l’étant comme tout ce qui est chez Heidegger, l’étant
comme soi perçu par l’autre chez Levinas), mais bien du dedans et pour soi que
cet inister se fait jour. A noter qu’instase, très rare, est un terme parfois
employé en philosophie et théologie, pour exprimer combien est intérieur et
loin de porter dehors “l’extase”.
182. A propos de l’effet produit par la rencontre des œuvres
de Giacometti, Viola, Rothko, voir la partie titrée Entre-temps de cette étude.
183. Marcel Proust, Du
Côté de chez Swann, p. 5 ; inspiré du temps bergsonien.
184. Représentation,
présentation, imprésentable ; puis Après
le sublime, état de l’esthétique, in « L’Inhumain ».
185. Voir la partie titrée Temps – in(s)-tant de cette étude.
186. Lyotard, Après le
sublime, état de l’esthétique.
187. D’où mon intérêt, sans ne rien savoir de la musique
– qu’au moins je perçois en toute “innocence” - pour Ives, Ligeti, Scelsi, etc.
188. Lyotard, Après le
sublime, état de l’esthétique.
189. Idem
190. Voir en particulier Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne.
191. Lyotard, Quelque
chose comme : “communication… sans communication”.
192. Ce pourquoi je pense qu’il faille à haute voix lire les
nombres d’Opalka ; autant pour “occuper l’esprit” dans une activité quasi
tautologique (je dis ce que je lis qui est ce que je vois), que pour saisir par
le souffle de la voix et les intermittences de la respiration, l’instant,
chaque instant, se creuser. Ainsi n’est plus perçue et pensée la progression
des nombres en grandeur (321, 322, 323… ∞) jusqu’à un infini “positif”,
quantitatif, mais au sein même la matière de cette progression, en infini
“négatif” ou in–fini qualitatif, qui creuse et annule cette progression
(entre 322 et 323, combien de nombres et lesquels ? 322, 322.5, 323…
322.5, 322.6, 322.7… 322.7, 322.07, 322.007, etc.)
193. Lyotard, Après le
sublime, état de l’esthétique.
194. Blanchot, L’Espace
littéraire.
195. Lyotard, Conservation
et couleur, in « L’Inhumain ».
196. Mallarmé,
Crise de vers, in « Igitur, Divagations, Un Coup de dés ». p. 259.
197.
Lyotard, Le Sublime et l’avant-garde.
198. Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Erste Fassung) in »Gesammelte Schriften, Band I-2«, p. 440, trad. Rochilz in « Œuvre, tome III », p. 75.
199. Il faut renvoyer à ce propos aux études de Georges Didi-Hüberman, La peinture incarnée ; Devant l’image et Fra Angelico, Dissemblance et figuration.
200. Walter
Benjamin, Das Passagen-Werk (Aufzeichnungen und
Materialien), In »Gesammelte
Schriften, Band V«, p. 560.
201. Heidegger, Remarques sur art, sculpture, espace.
202. Selon le mot de Diderot sur La Raie de Chardin, op. cit.
203.
Expression de Maurice Merleau-Ponty, L’Œil
et l’esprit.
204. Voir
les deux parties suivantes de cette étude : Entre et A-perçu –
a-perdu.
205. Voir
l’ouverture de cette étude : Point
de vue
206.
Personnage du texte de Joyce, Ulysse.
Texte dont je me souviens parfaitement de mes réactions à première lecture,
tant impression et contre coup furent fort. Dès la première phrase attachement
sans borne à Mulligan – tant les phrases qui le font sont fortes :
“Stately, plump
Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a bowl of lather on which a mirror
and a razor lay crossed. A yellow dressing gown, ungirdled, was sustained
gently-behind him by the mild morning air. He held the bowl aloft and intoned:
- Introibo ad
altare Dei.
Halted, he peered
down the dark winding stairs and called up coarsely:
- Come up,
Kinch. Come up, you fearful jesuit.
Solemnly he
came forward and mounted the round gunrest. He faced about and blessed gravely
thrice the tower, the surrounding country and the awaking mountains. Then,
catching sight of Stephen Dedalus, he bent towards him and made rapid crosses
in the air, gurgling in his throat and shaking his head.” (Ulysses, p. 1)
Mulligan
majestueux, “Chrysotomos”, fort et
brillant face au pâle Stephan endormi, blessé par la lumière et son ami ;
Mulligan qui rapidement se révèle in fat ironique étudiant bouffon, et est
rejeté en personnage de troisième plan. Entré comme un héros, il est effacé par
Joyce, déception du lecteur que j’étais, croyant tenir sous mes yeux un roman
épique.
Quelques pages
passées, c’est Stephen Dedalus qui pour certain est mon attache : affinité
intellectuelle avec celui qui questionne – expérimente, cherche –
et ne trouve pas, tourné vers le lointain, par sensation – intellection
et “ineluctable modality of the visible”
(voir la partie titrée Point de vue
de cette étude) se fait héros. Non d’un roman épique, mais philosophique, héros
avec lequel se construit non l’admiration du majestueux, mais la joyeuse
identification du lecteur. Mais c’est à la désespérance de se voir abandonné de
lui que nous livre Joyce à la p. 65 :
“Mr Lepold
Bloom ate with relish the inner organs of beasts fowls. He liked thick
giblet soup, nutty gizzards, a stuffed roast heart, liver slices fried with
crustcrumbs, fried hencod's roes. Most of all he liked grilled mutton kidneys
which gave to his palate a fine tang of faintly scented urine”.
Et c’est ce Bloom banal, dégueulasse déjection
que Joyce nous force à suivre ! Il ne nous en libérera, pour le monologue
de sa femme Molly qu’en p. 871, Bloom insipide publiciste qui erre de
charcuterie en ruelle, de journal ou boulevard, de bar en bordel, Bloom serait
Ulysse, ce héros attendu ? Moyen-vieux, insignifiant, passif, qui n’a pas
même cette sorte de noblesse âgée qui semble être attribuée à Simon Dedalus,
père de Stephen. Un sot.
C’était en 1988 (et je venais de finir la Recherche de Proust après avoir fait le
deuil de Swann, et appris que l’antipathique Verdurin allait être la
victorieuse des temps prochains, me demandant alors – et toujours –
qui est Marcel, ce “Je” qui retrouve ce temps passé). Repris en 1992, j’avais
une autre idée de l’Ulysse mythologique : oui, un sot, rusé parce que sot,
peu courageux – il fait tout pour ne pas partir guerroyer, puis
passivement subit tout pour se perdre au loin et ne pas rentrer –. Et là,
j’ai relu avec courage contre mes convictions le texte de Joyce, et peut-être
sinon mieux compris, mieux accepté. Il importe que Bloom ne soit pas attachant,
il importe qu’il n’y ait ni héros, ni majestuosité ni identification ; les
personnages, leurs actions, le récit n’importent pas. C’est la langue qui
importe, l’écriture, les mots, les sons, les couleurs, les images – et
c’est en anglais (même si la traduction française a été revue par l’auteur) que
cela se donne. Et ces mots peuvent s’emparer du plus proche, pour transformer
chaque mot commun en un mot autre, rendre sa sonorité, lui donner une couleur,
en faire image, révéler un lointain.
Ce mot-image rappelle ce que Duchamp dit de ses
titres : « Cette imprécision, cette indécision, et quand même… ça ne fait
pas non sens… ce n’est même pas du non sens, mais ça donne une direction… […]
très inquiétante, donc vous voyez c’est
c’est une veine qui m’a com’ que
j’aimais bien exploiter ou que j’ j’essayais
d’exploiter et… je le fais dans ce titre là ou dans la peinture elle-même ou
dans la l’exécution du Grand verre
c’était la même idée dans tout ce qui composait ce verre. C’est de d’obtenir des effets qui partent en
tangentes, d’une tradition ou d’une acceptation normale des choses comme “la
fenêtre se ferme” le “la porte
s’ouvre” et cætera qui sont des
choses trop connues depuis trop longtemps et dont on aurai jamais pu parler,
comprenez-vous ? Après tout un tableau est est un diagramme, d’une idée.»
207. Τηλέμαχος :
têlé – au loin, makhos – combattre.
208. Stephen Dedalus semble trouver en Bloom un
père de substitution, le rêvant en apparition (3. Proteus), l’aidant à sortir du bordel (15. Circe), puis le guidant de ruelles en abris (16. Eumaeus). Bloom, relation de Simon
Dedalus, père de Stephan, est pour Stephan-Télémaque cet Ulysse revenu qui
peut-être n’est pas l’Ulysse (son père) qui avait quitté Ithaque vingt ans plus
tôt.
209. Molly Bloom, jeune fille Marion Tweedy,
Pénélope, vient du lointain : des antipodes de la présence anglaise en
Europe. Au roc irlandais occupé répond l’occupation de roc de Gibraltar ;
à l’île qui gît entre la Mer d’Irlande et l’Atlantique nord répond la péninsule
qui se dresse entre Méditerranée et Atlantique sud ; à Erin ramenée à la seule ville de Dublin
répond Gibraltar qui est roc et ville. Fille d’un officier irlandais exilé et
d’une locale espagnole, elle est encore le lointain ; ré-exilée en Irlande
et dans sa chambre, elle pratique l’art choral, encore le lointain (opposée à
la profession de publiciste de son mari). Et, alors que c’est Bloom qui sort,
s’éloigne, c’est elle qui reste et est l’éloignée au plus lointain.
210. Le
concept (ou quasi concept) de lalangue
est apparu en lapsus lors d’une conférence publique, Jacques Lacan le déploie
dans Encore, séminaire XX, 1972-73.
211. Voir
Lacan, La Relation d’objet, séminaire IV,
1956-57.
212. Lacan,
Le Transfert, séminaire VIII,
1961-61.
213. Idem
et L’Angoisse, séminaire X, 1962-63.
214. Voir
en particulier Michel Foucault, Parler ;
L’Homme et ses doubles (Le retour du
langage et La Place du roi) et Les Sciences humaines, in « Les
Mots et les choses », pp. 92-137, 314-323 et 355-398.
215.
Marion, La Banalité de la saturation, op. cit.
216. Joyce,
Ulysse, trad. Morel, vol. 1, p. 367.
217. Extraits de James Joyce, Ulysses, pp. 328-376.
218. Joyce,
Ulysse, trad. Morel, vol. 1, p. 419.
219.
Hölderlin, Der Gangs Auf Land [Promenade
à la campagne].
220. Hölderlin,
Brot und Wein (3) [Pain et vin (3)]
221.
Hölderlin, Der Gangs Auf Land.
222. Novalis,
Hymnen an die Nacht I (1799,
Handschriftliche Fassung), in »Gedichte, Die Lehrlinge zu Sais«, p.
125.[Hymnes à la nuit, I,
p. 119].
223.
Immédiatement venu, le rappel de la révélation de Roquentin, devant sa racine
de marionnier, dans La Nausée de
Sartre, p. 178.
224.
έποχή – épochè,
concept husserlien : mise en suspens de la réalité extérieure du monde qui
permet la réduction phénoménologique au “je” pur. L’extérieur ne se donnera
ensuite que comme apparition dans ce “je” et phénomène du “je”. Voir en
particuler Husserl, Méditations
cartésiennes, p. 46.
225.
Novalis, Hymnen an die Nacht 1 (1799,
Handschriftliche Fassung), p. 126. [Hymnes à la nuit, 1, p. 119].
226. Novalis,
Hymnen an die Nacht 1 (1800, Athenaeum
Fassung), in »Gedichte, Die Lehrlinge zu
Sais«, p. 150. [Hymnes à la nuit, 1, pp.
120-121].
227. Alors
qu’Husserl insiste dans les Médidations
cartésiennes, pp. 59-60, sur la séparation à maintenir entre “l’expérience […] du moi” et “la critique même
de l’expérience […] et consécutivement celle de la connaissance […] en général”.
Pour ne point allourdir la lecture, est fait ici (et ensuite) élision du
caractère “transcendental” de ce moi ; soit d’un moi supérieur aux
choses, comme supérieur et indépendant de l’expérience, comme condition de
possibilité de l’expérience ; moi ou ego transcendental distingué du moi
empirique, tel celui qui se rencontre dans l’expérience.
228. Stephen
Dedalus in Ulysses,pp. 45-46 ; [trad. p. 56].
229.
Novalis, Hymnen an die Nacht 2 und 4
(1800, Athenaeum Fassung), pp. 151-152. [Hymnes
à la nuit,2 et 4, pp. 123 et 127].
230. Voir
en particulier Jacques Derrida, Mémoires
d’aveugles. En rappel, la condition de Tirésias dans les tragédies de
Sophocle, tels Œdipe Roi et Antigone.
231. Carl
Gustav Carus, Neufs lettres sur la
peinture de paysage, in « Carl Gustav, Caspar David Friedrich, de la
peinture de paysage », lettre III, p. 68.
232. Idem,
lettre VIII, p. 127.
233. Blanchot,
Thomas l’obscur (nouvelle version),
pp.17-18, voir la partie titrée Points de
vue de cette étude.
234. Caspar
David Friedrich, Considérations à propos
d’une collection de peinture, in « Carl Gustav, Caspar David
Friedrich, de la peinture de paysage », p. 170.
235. Appel
à Kafka, Le Château.
236. Kafka,
Vor dem Gesetz [Devant la Loi].
237.
Husserl, Méditations cartésiennes, deuxième
méditation § 15, 16 et 17, pp. 68-78.
238. Ce
pourquoi les formes univoques d’art ne m’intéressent guère : du discours
classique (“lisez l’histoire et le tableau”, Nicolas Poussin) aux manifestes
univoques du radicalisme minimal et conceptuel (“what you see is what you see”,
Stella ; “art is the definition of art”, Kosuth), passant par les
déclarations de l’art “engagé”
239. En
dehors des apparences, cette dissociation est manifeste chez Marcel
Duchamp ; voir en plus de son “retrait”, l’analyse qu’il fait de la
dissociation de l’artiste lui-même (“qui fait, mais ne sait pas ce qu’il
fait”), de l’objet d’art (en le dissociant de sa valeur d’art ou de sa donnée
d’objet) et de l’objet (en le dissociant de son usage d’objet), de la chaîne
qui va de l’émission artistique à sa réception par le regardeur. Cette
dissociation qu’il connaît, il s’en amuse et nous la livre avec humour
“surréaliste” :
« La cage à sucre s’appelle : Pourquoi
ne pas éternuer [raclement de gorge], pourquoi ne pas éternuer. Evidemment,
ce titre vous d... vous semble
bizarre, parce qu’il n’y pa’ aucun
rapport, vraiment, entre les morceaux du sucre et et d’un, un éternuement. De plus, ces morceaux de sucre ne sont pas
en sucre, ils sont en marbre, donc c’est déjà une autre chose, puisque quand on
soulève la cage on est l’ surpris par
le, la différence de poids qu’on
attendait, qu’on, on trouve. Il y a
aussi un thermomètre… dans le coin, qui est supposé donner la température des
morceaux de marbre pour prouver bien que ce n’est pas du sucre ; et cætera , et cætera . Voici le genre
de choses qui m’intéressait dans cette histoire là ; ça a été fait en
vingt-trois, je crois.
- Mais est-ce que vous cherchiez à… à vous
moquer des autres ?
Non ! j’s moqué de
moi-même en tout cas, d’abord ! Dissociation entre l’idée d’éternuement et
p’ l’idée de pourquoi ne pas éternuer parce qu’on n’éternue pas
à volonté malgré tout, on éternue m’
malgré soit souvent ; donc pourquoi ne pas éternuer, c’est que parce que on ne peut pas éternuer… à
volonté. » Film Jeu d’échec avec
Marcel Duchamp.
Du côté de l’objet, qu’il soit vérifiable par le poids que les morceaux
de sucre ne sont pas en sucre mais en marbre entre en complète dissociation
avec la preuve par la température que le marbre n’est pas du sucre. Du côté du
sujet, la dissociation s’effectue entre ce que veux l’artiste, ce qui lui
arrive malgré soi et ce qui se peut pas. Entre l’objet, le sujet artiste et le
sujet regardeur, le titre de ce ready-made aidé joue de la dissociation même.
240. Carl
Gustave Carus, Neuf lettres sur la
peinture de paysage, op. cit. Lettre VI, pp. 101, 104-105.
241. Extraits de Lautréamont, Les
Chants de Maldoror, chant cinquième, p. 215, chant sixième, p. 234 (tant
réutilisé par Breton et les surréalistes).
242. Paul
Klee, reconstruit par Marchand, cité par Merleau Ponty, L’Œil et l’esprit,p. 31.
243. « Les œuvres des aliénés, sont à prendre plus au sérieux
que tous les musées des beaux-arts, dès lors qu’il s’agit de réformer l’art
aujourd’hui. Pour ne pas simplement archaïser, il faut remonter plus
haut. » (Paul Klee, Ausstellungbesbrechung
in »Die Alpen, Heft 5, Januar 1912«, p.302)
244.
Rimbaud, Lettre à Georges Isambard, Charleville,
13 mai 1871.
245. Lautréamont, Les Chants de Maldoror, op.
cit. chant premier, pp. 26 et 30.
246. “Léman” est suivi de noms initiés
par la lettre “L” (Lohengrin, Lombano) comme Lautréamont : peut-être
allusion à Jacques-Edmont Léman, peintre ; ou au lac Léman au travers les
lectures que Lautréamont a pu faire de Byron et Mary Shelley ; anagramme
possible de “mal né” ou métathèse de “mêlant”. Léman est le serviteur de
Maldoror, accompagné du chien Sultan.
247. Lautréamont,
Les Chants de
Maldoror, chant
troisième, pp. 121, 124-125 et 139.
248. Idem,
chant quatrième, pp. 178-179.
249. Idem,
chant cinquième, pp. 199, 201-203, 215 et champ sixième, p. 234.
250. Idem,
chant sixième, p. 260.
251.
Isidore Ducasse, dit Lautréamont, composa Maldoror
(mal d’horreur, mal d’or or, ma dolor) de 1868 à 1869, décédant l’année
suivante à vingt-quatre ans. La qualité de prématuration de ces écrits bruts en
permet de multiples lectures et a ceci d’intéressant que n’ayant point atteint
une maturité formelle à l’écriture, chaque lecture voit grandir et élève un
autre sens au texte, une autre individualité au texte, un autre être accompli
du texte.
252. Voir
en particulier Husserl, Méditations
cartésiennes, § 18, pp. 78-82 : L’identification
et toute la Quatrième méditation, pp.
113-147.
253. Jacques
Lacan, Les Quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse, séminaire XI,
p. 146.
254. C’est
évidemment ici que prend origine la quête surréaliste qui, si elle sut produire
telle faillite par des méthodes avant tout syntaxiques – littéraires
– n’est guère parvenue à la réaliser au travers l’image, sans doute parce
que restant une a-syntaxe de figuration, la peinture surréaliste se résoud
assez rapidement dans la reconnaissance des formes figurées et échappe à la
collision des syntaxes, vécue comme simple amusement. Par le même hiatus, il me
paraît que la pensée romantique, poésie, parvient à ce point de faillite que
toute l’imagerie de cette époque, peinture, ne rend que comme paysage panthéisé
ou apparition fantastique qui évitent, par la grossièreté rendue visible de
l’incroyable (très bien ensuite exploitée par le cinéma d’horreur, de science
fiction ou de rétro fiction) la rencontre avec l’a-syntaxical radical. Sauvons
par la suite L’Année dernière à Marienbad
et quelques autres propositions de la “nouvelle vague”, qui parviennent à
produire, en image, cette défaite de la synthèse.
255. Husserl,
Méditations cartésiennes, p. 80. A
noter qu’il ne développe pas en quoi ces synthèses sont d’une toute autre
espèce.
256. Marcel
Duchamp, première partie La Boîte de 1914,
seconde partie In Da Costa, Le Memento
universel, Paris 1958, in « Duchamp du signe », pp. 37 et 276.
257. Etre
c’est être perçu ou percevoir. S’il n’y a plus de perception ou rien a
percevoir, y a-t-il de l’être ; ou comment être certain que ce qui est
perçu par ma perception n’est pas illusion, fantôme ou fantasme ? –
que soit j’existe et le monde n’existe pas, n’est qu’un rêve en moi ; soit que
le monde existe et que je n’existe pas, n’étant qu’un rêve du monde.
258. Lacan,
Les Quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, pp. 93-94.
259. Voir L’Œil et l’esprit, intégralement traversé par cette “image” et Le Visible et l’invisible, op. cit. (notes de travail – La Chair du monde), pp.
302-304.
260. Husserl,
Méditations cartésiennes, pp. 62-65.
261. Lacan,
Les Quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, pp. 96-97.
262. Qui ne
regarde que moi, mais par honnêteté me dois de questionner : cet objet a, ce perdu désiré, n’est-il pas pour
moi, simplement l’autre ? un individu humain autre ? le visage d’un
autre ? Il m’apparaît de plus en plus clair que, pour moi, autrui est
toujours lointain, s’éloigne – et m’éloigne.
263. Lacan,
Les Quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, p. 145.
264. Idem,
pp. 31, 34, 47, 61 et 85.
265. Idem,
p. 85.
266. Marcel
Proust, extrait de Jean Santeuil,
voir aussi la partie de cette étude
titrée Points de vue.
267. Voir
la partie de cette étude titrée Entr’
aperçues. Marcel Proust, La
Prisonnière, pp. 176-177, dont on peut ici placer en exergue les passages
suivants :
« Cependant la gravité de ses étourdissements ne lui
échappait pas [il voit et peut encore regarder, se voir se voir]. […] “Je ne
voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers
de cette exposition.” [Et n’ayant pas encore perdu ce rapport au voir, au
regard, il peut encore, avec ironie, se battre pour vivre] Il se
répétait : “Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur
jaune.” [Il a ici cessé de voir, et le regard n’est plus que réitération, sans
retour, in fine sans conscience] Cependant, il s’abattit sur un canapé
circulaire ; ainsi brusquement il cessa de penser que sa vie était en jeu
et, revenant à l’optimisme, se dit : “C’est une simple indigestion que
m’ont données ces pommes de terre pas assez cuites, ce n’est rien.” [dénégation
de ce qu’il vit : ne plus rien voir ni regarder, ce sentir sujet perdu] Un
nouveau coup l’abattit, il roula du canapé par terre où accoururent tous les
visiteurs et gardiens [alors seuls les autres voient, lui a chu, d’une chute
inaperçue du sujet Bergotte - réduit à zéro]. Il était mort. »
268. Lacan,
Les Quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, p. 89.
269. Voir,
de l’auteur, Courbet outre-monde,
essai, sans doute à retravailler, sur la centralité optique d’une zone noire
dans les paysages de Courbet.
270. Lacan,
Les Quatre concepts fondamentaux de la
psychanalyse, pp. 123, 127 et 129.
271. Idem,
voir les pp. 159-163.
272. Idem,
p. 204. Par l’élargissement de la question, ici envisagée par Lacan sous
l’angle du voyeurisme, à la question de la relation à tout regard, il est fait
élision du qualificatif de “honte” attribué à la conflagration. Cette
conflagration peut aussi bien être, extrême surprise, destabilisation, doute,
brûlure, vacillement, affect de perte, etc.
273. Idem,
p. 232.
274. Georges Didi-Hüberman, Devant l’image, pp. 218, 220, 313 puis
277. Voir du même auteur, La Peinture
incarnée, pp. 20-62 et son analyse des veinures de marbre et des
luminosités des fonds de fresque dans Fra
Angelico, dissemblance et figuration.
275. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente. Ende 1870 – April 1871 [Fragments posthume 11(1), dédicace à Wagner,
Lugano 22 février 1871, jour anniversaire de Schopenhauer, in « La
Naissance de la tragédie »], p. 244 (traduction modifiée).
276. Voir
la part de cette étude titrée R’ aperçu
et pour l’intégralité de la scène chez James Joyce, Ulysses, pp. 328-376 et trad. Morel, vol. 1, pp. 367-419.
277. Voir l’extraction et la première analyse effectuée dans
la part de cette étude titrée R’ aperçu.
278.
Seconde extraction des pp. 328-376 du texte d’Ulysses, couleurs seules.
279. Même
si l’instrument musical de l’Ormond Bar est un piano, accompagnant le chant
choral des voix masculines, quelque chose des mots “me” vibre comme des cordes.
280. Note
de février 2017, penser à tenter de le réaliser, en couleur, en son, peut-être
en mouvement (vidéo)
281.
Frederic Matys Thursz, Entretien avec
Bernard Ceysson, in « Repères, Cahier d’art contemporain, N°
79 ».
282. Pour
un développement de la question du pli, voir Gilles Deleuze, Le Pli, Leibniz et le baroque.
283.
Novalis, Hymnes à la nuit, op. cit. hymne
IV.
284.
Nicolas Poussin (1594-1665) est à Paris en 1612, où il entre comme apprenti en
l’atelier de Georges Lallemant de Lorraine. Il rencontre Alexandre
Courtois, valet de chambre de Marie de Médicis et grand collectionneur.
285. Frans Pourbus (ou Porbus) dit le Jeune (1570-1622), est
à Paris dans le cercle de la sœur de Marie de Médicis. Très marqué par
l’influence des portraits de cour de Rubens, remarqué pour son Portrait
d’Henri IV en cuirasse, il deviendra peintre du roi Louis XIII en 1618 (Portrait de Louis XIII en armure en 1620).
286. Frenhofer est invention de l’écrivain,
“type” même de l’anti-Poussin. Présenté âgé, il se tient comme avant Rubens et
Caravage (peintres dont on connaît combien Nicolas Poussin a détesté les
œuvres) et après Titien qu’il étudie. Il semble être l’incarnation de ce
qu’aurait put devenir le vieux Titien, s’il n’était mort en 1576 : un
peintre de l’échec de la peinture, ne rencontrant dans sa quête du pli de
l’opacité en transparence que l’opacité pure. A l’inverse, Poussin s’affirmera
dès ses années romaines (1624) proche de Vouet et d’un retour à la transparence
– et au dessin – raphaélesque, marquant la rupture avec la
recherche baroque et l’affirmation de la rationalité classique.
287. Balzac, Le Chef d’œuvre inconnu, ici modifié pour être raccourcis et ramené
au symptôme même de l’échec dans l’opacité.
288. Pour une étude approfondie de
l’écart entre Poussin et le baroque, ainsi que de l’analyse sémiologique de ses
peintures, voir Louis Marin, Détruire la
peinture et Sublime Poussin.
289.
Nicolas Poussin, Lettre à M. De Chambrai,
de Rome, le 16 mars 1665.
290. Tel qu’Yves Klein l’exposa à la Galerie Iris Clert, Paris 1958. Exposition qui
toutefois tient du même paradoxe que 4’33’’
de Cage. Il lui faut un contexte plein, un milieu opaque pour exister : la
galerie, l’annonce même de l’exposition et le matériel médiatique supposé par
cette annonce (cartons d’invitation, encarts, revues de presse, critiques,
etc.) et plus encore, déporter un plein à l’entrée de la galerie, le visiteur devant pousser un épais rideau bleu pour
découvrir la salle vide.
291. Ce que
fit encore Klein avec la Zone de
Sensibilité Picturale Immatérielle (1959-62), mais avec la
même impossibilité d’atteindre à la transparence totale : l’air n’existant
que comme élément d’une transaction financière, consistant à son échange contre
de l’or, ensuite noyé dans la Seine, mais légitimée par un chèque écrit, qui
aurait dû être brûlé, contrat conservé par la plupart des collectionneurs, dont l’opacité du papier signe la
transaction. Des photographies, conservées par Klein, de ces actions
transparentes assurent la même opacité propre à leur donner existence.
292. Voir
Blanchot, Thomas l’obscur (nouvelle version), pp. 15-18 et
la partie titrée Points de vue de
cette étude.
293. Voir la même partie et Joyce, Ulysses, pp. 45-46.
294. Voir
les parties titrées A–concevoir et
Zéro, un infini de cette étude
295. Shakespeare, Hamlet, act 2, scene 2.
296. Voir la Lettre de Poussin sur La
Manne : « Quand vous aurez reçu [votre tableau], je vous supplie, si
vous le trouvez bien, de l'orner d'un peu de bordure, car il en a besoin, afin
qu'en le considérant en toutes ses parties , les rayons visuels soient retenus
et non point épars au-dehors, et que l'œil ne reçoive pas les images des autres
objets voisins qui, venant pêle-mêle avec les choses peintes , confondent le
jour. Il seroit fort à propos que ladite bordure fût dorée d'or mat tout
simplement, car il s'unit très doucement avec les couleurs, sans les
offenser. » Lettre à M. De
Chantelou, de Rome, le 19 mars 1639.
297. Ces
points seraient à développer ; ce qui j’espère donnera lieu à un prochaine
étude.
298. A quoi
il faut ajouter la surveillance rapprochée du personnel encadrant du musée, qui
de manière claire est ici plus garde que gardien, conférant à la performance un
aspect de contrôle dont sa sincérité aurait pu se passer.
299. A
l’inverse, la scénographie de Nightsea
Crossing plaçait
Marina et Ulay toujours même dans un face à face différent, de par les lieux,
la mise en scène, le rapport esthétisé à l’espace.
300. Il y a
heureuse dissipation aussi des œuvres de “spectacle” des années de “crise”
d’Abramović (1988-2010), soit des effets de mise en scène qui, plus loin que Nightsea Crossing, n’entretenaient plus
qu’un rapport esthétique à l’espace (Balkan
Baroque). Si The Artist is Present
n’est pas totalement dénué de mise en scène (vêtement, structure spatiale et,
autour de la performance, gestion et contrôle des visiteurs par l’organisation
muséale, puis mise en scène du film documentaire éponyme, sorte de reality show performance construite dans
la performance), cette performance replace clairement son esthétisme dans une
éthique.
301. En
rappel à la partie de cette étude titrée Entre,
έποχή – épochè,
reprise du concept husserlien de mise en suspens de la réalité extérieure
du monde qui permet la réduction phénoménologique au “je” pur.
302. Marina
Abramović in Akers,
Matthew et Dupre, Jeff, Marina Abramović, The Artist is Present, film.
303. Abramović
décidera de supprimer cette table, passé la mi-durée de la performance. Ne
restera alors plus que deux chaises, la sienne et celle de son vis-à-vis, et
entre deux, le vide. L’apparition du “volume vide” (d’art ?) dans cet
espace semble continuer d’advenir, flottant à mi-distance et mi-hauteur entre
l’échange des regards des deux protagonistes.
304. Le film The
Artist is Present d’Akers et Dupre travaille par contre cet aspect
d’effort, de douleur, de découragement ; de facilité, de douceur, de
plaisir ; ce par la dramaturgie de son montage, l’ajout pathétique du son
musical extradiégétique, et de scènes “off”, intimes, sinon jouées du moins
choisies. Ce film est ainsi un documentaire, et non un document. Sa fonction
n’est pas de conserver trace de la performance mais de construire un
discours propre à faire de cette performance une épopée. Il agit de fait comme
un “produit dérivé” où l’émotionnel se veut sans doute gage d’un certain succès
commercial. Pour les réalisateurs et les producteurs, ce but est évident ;
il pourrait l’être moins pour l’artiste, hors la dépendance de fait que tout artiste
entretient avec la commercialisation de son œuvre – gage de survie
économique – et avec la communication de cette œuvre – gage de
reconnaissance publique –.
305. Ce
même si de nombreux artistes, acteurs, personnalité de champ de l’art ou du
show business sont venus comme vis-à-vis, ils l’ont été comme quiconque
(toujours sous réserve de ce qu’en montre le film précité).
306. Alberto
Giacometti, Pourquoi je suis sculpteur,
entretien avec André Parinaud, in « Arts, N°873, juin 1962 »
repris in « Pourquoi je suis sculpteur », pp. 31-32.
307. Marina
Abramović, The Artist is
Present, film.
308.
Extraits, travaillés dans les parties titrée R’ aperçu et Faire –
dé–faire de cette étude, du chapitre Sirens de l’Ulysses de
Joyce, pp. 328-376.
309.
Heidegger, Remarques sur art, sculpture,
espace, p. 27.
310. Levinas,
Totalité et infini, essai sur l’extériorité, pp. 137-139.
311. Rouge
prisé par les photographes et les réalisateurs du film The Artist is Present, de par son aspect
plus spectaculaire que les robes outremer ou blanche, mais aussi par
Abramović, la vivacité de ce rouge la protégeant, la “maintenant” en
elle-même.
312. Levinas, Totalité
et infini, p. 150.
313. Idem, pp.
144-146.
314. Idem, p. 151.
315. A
notre époque des réseaux sociaux – où l’important semble d’émettre,
quoique soit le contenu de l’émission – de nombreux commentaires sont à
trouver sur la myopie de Marina Abramović : elle ne verrait
pas, ou verrait de manière si floue, ses vis-à-vis, ce qui la maintient à
distance, la protège et facilite la performance, voire en fait un fake inopérant, illégitime. Il est vrai
que filmée hors performance par Akers
et Dupre, Abramović porte souvent des lunettes (semble-t-il plus
pour lire que pour voir au loin, ce qui à 63 ans est assez fréquent) ;
reste que myope ou pas, tel ne semble pas être la question, tant – tel
qu’il sera démontré – savoir si elle voit celui qui lui fait face n’a
aucune importance.
316. Alberto
Giacometti, Pourquoi je suis sculpteur,
pp. 35-36.
317. Levinas, Totalité
et infini, pp. 61-62.
318. Idem, p.
43.
319. Idem, p. 72.
320. Idem, pp. 218-219.
321. Marina
Abramović, The Artist is
Present, film.
322. Levinas, Totalité
et infini, pp. 62-63.
323. Idem, p. 126.
324. Mallarmé, L’Azur,
in « Poésies », pp. 20-21.
325. Levinas,
Totalité et infini, pp. 206-208.
326. Idem, pp.
158-159.
327. Idem, p. 211.
328. Idem,
pp. 214-215.
329. Idem, p. 222.
330. Idem, p. 91.
331. Idem, p. 152.
332. Idem, pp. 212-213.
333. Idem, pp. 215-216.
334. Idem, p. 224.
335. Idem, p. 281.
336. Idem, pp. 328-329.
337.
Reprise de la partie de cette étude titrée Entre-temps.
338. Levinas, Totalité
et infini, pp. 218-219.
339. Idem, p. 330.
340. Le
film The Artist is Present montre
quelques pratiques “exotiques” de ces exercices. Clin d’œil à notre époque,
Marina demande à tous les jeunes partcipants de déposer leur téléphone portable,
le temps du week-end passé chez elle, dans un panier d’osier.
341. Counting de Rice, 2014, CAC Genève.
342. Levinas, Totalité
et infini, pp. 214-215.
343. Idem, p. 222.
344. Idem, p. 330.
345. C’est ainsi que j’ai conçu
l’enseignement, par ailleurs perçu comme activité artistique – après
l’abandon (mais n’abandonne-t-on jamais – « Tout commence par une
interruption » écrit Valéry dans Dialogue
de nuit, in « Mauvaises
pensées et autres ») de la peinture.
Voir au sujet de l’enseignement comme art, de l’auteur, L’expérience de l’enseignement, Lausanne, IFFP, 2012 réédition
chperret.net, 2015.
346.
Husserl, Méditations cartésiennes, cinquième
méditation (5.42), pp. 149-150.
347. Ici
s’ouvre un hiatus, puisque je n’ai pas l’impression de percevoir les autres,
l’autre, Marina Abramović, comme existants réellement .
348.
Husserl, Méditations cartésiennes, 5.43,
pp. 150-152.
349. Idem, 5.44,
p. 155.
350. Le
terme “homme” présent dans la traduction est volontairement remplacé par
“humain” – Mench et non Mann –.
351. Husserl,
Méditations cartésiennes, 5.44, pp.
158-160.
352. Idem, 5.48, pp. 172-174.
353. Idem, 5.50, pp. 177-181.
354. Idem, 5.52, pp. 186-189.
355. Voir idem, 5.55, pp. 203-204 :
« Or, le sens de l’aperception qui réussit à atteindre
l’autre implique nécessairement une expérience immédiate de l’identité entre le monde des autres,
monde appartenant à leurs systèmes de
phénomènes, et le monde de mon
système de phénomène. […] [Si il y a différence et anomalie], il faut bien que l’anomalie
se constitue d’abord elle-même comme telle, et elle ne le peut que sur la
base de la normalité qui, en soi, la
précède. »
- Mais cette “normalité” n’est-elle pas fondée par une
instance qui transcende le – les – “moi”, un monde commun admis par
ceux qui y vivent, croyance, opinion, connaissance ; un monde commun
transmis à ceux qui y vivent, éducation, culture, loi ; un monde commun
communiqué entre ceux qui y vivent, langage, rituel, représentation ? –
Husserl y revient en 5.58 (pp. 213-219), mais comme découlant de ce qui précède
et non comme ce qui apparaît comme fondement de ce qui se développe ici. En ce
sens, je me demande si l’espace “installé” de The Artist is Present n’est pas précondition au vis-à-vis. A
savoir, le choix de l’atrium du MoMA, la délimitation d’un carré “performatif”
par les lignes de sol et l’éclairage, la disposition mobilière du face-à-face
des deux chaises médiatisées par la table, le choix même des matériaux et
formes de ces meubles ; tout ceci détermine par “convention” partagée un
monde “normalement” saisi pas tous comme monde
de l’art – y compris l’accès au MoMA, la billetterie,
l’infrastructure annexe – vestiaire, toilettes, cafétéria, librairie
– et la surveillance de l’institution. Ceci constitue la “normalité” qui
fait que l’exact même vis-à-vis, s’il avait lieu dans la rue, ou dans un centre
commercial, n’ouvrirait ni le même monde ni la même compréhension – on penserait
à un acte de folie, dérangeant l’ordre public ou à quelque manifestation
politique.
« […] [Sinon] il ne saurait autrement y avoir pour nous
ni sens ni existence. Le monde possède l’existence grâce à la vérification
concordante et mise en commun, [et, en particulier par le langage] de la
constitution aperceptive […] qui s’effectue dans et par la marche […] (ce qui
implique des “corrections” constantes qui rétablissent la cohérence) de notre
[commune] expérience vivante [dans un commun donné, auquel les moi
participent]. La concordance se maintient aussi grâce à la modification des
aperceptions due à la distinction entre la normalité et les anomalies –
celles-ci étant comprises comme modifications intentionnelles de celles-là –
grâce aux nouvelles unités constituées dans la variation de ces
anomalies. »
- Alors ce serait l’effet de certaines “découvertes”
scientifiques (ou artistiques peut-être), telle par exemple la révolution
copernicienne. Ces “trouvailles” de “chercheurs” peuvent par ailleurs être
refusées, ou peuvent prendre temps à s’accepter, à s’intégrer. Si par ailleurs
nous nommons “chercheur”, “scientifique”, “artiste”, “poète” ou “prophète” les
premiers “je” qui proposent à autrui une anomalie, force est de constater que
la structure préconstituée comme “normale” par le consensus des vues d’autrui,
structure qui, si elle est construite, peut se nommer “institution”,
réagit : accepte, refuse, critique, tolère, etc. A mieux, c’est le
jugement des “pairs” qui est convoqué, le même légitimant dans le cadre du même
l’écart d’autrui – ce qui est par ici est la circonstance : le MoMA
légitime comme valide l’anomalie qu’avait pu représenter le travail
d’Abramović et le conduit à la normalité.
Sur l’illusion encore ; à noter que le film The Artist is Present montre Marina
risquer de faillir face à un prestigitateur. Seul son galeriste, Sean Kelly, la
convainc de ne pas collaborer avec cet illusionniste professionnel.
356. Voir Levinas, Diachronie et représentation in
« Entre nous, essais sur le penser à l’autre », p. 167 :
« […] Il s’agirait d’entendre toute altérité que se rassemble, s’accueille
et se synchronise dans la présence à l’intérieur du je pense et qui ainsi s’assume dans l’identité du Moi – il s’agit d’entendre cette
altérité assumée par la pensée de l’identique – comme sienne et, par le fait même, de ramener
son autre au même. L’autre se fait le propre de moi dans le savoir […].
L’intentionnalité dans la visée et la thématisation de l’être –
c’est-à-dire dans la présence – est retour à soi autant que sortie de
soi.
Dans la pensée entendue comme
vision, connaissance et intentionnalité, l’intelligibilité signifie donc la
réduction de l’Autre au Même, la synchronie comme être dans son rassemblement égologique. »
357. Voir Levinas, Totalité
et infini, pp. 27-28 : « Le pouvoir
du Moi ne franchira pas la distance qu’indique l’altérité de l’Autre. […]
L’absolument Autre, c’est Autrui. Il ne fait pas nombre avec moi. La
collectivité où je dis “tu” ou “nous” n’est pas un pluriel de “je”. Moi, toi,
ce ne sont pas là individus d’un concept commun. Ni la possession, ni l’unité
du nombre, ni l’unité du concept, ne me rattachent à autrui. »
358. Husserl, Méditations cartésiennes, 5.53, pp. 189-191.
359. Voir Levinas, Totalité et infini, pp. 129-130 :
« L’intelligibilité, le fait même de la représentation, est la possibilité
pour l’Autre de se déterminer par le Même, sans déterminer le Même, sans
introduire d’altérité en lui, exercice libre du Même. Disparition, dans le
Même, du moi opposé au non-moi. […] Le Même y est en relation avec l’Autre,
mais de telle manière, que l’Autre n’y détermine pas le Même, que c’est
toujours le Même qui détermine l’Autre. »
360. Husserl, Méditations
cartésiennes, 5.54, pp.
191-195.
361. Voir
Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la
banalité du mal.
362. Levinas, Diachronie et
représentation, op. cit. , p. 175.
363. Idem, p.176.
364. Husserl, Méditations
cartésiennes, 5.55, pp. 196-199.
365. Idem, 5.49, pp. 174-176.
366. Voir Derrida, L’Ecriture
et la différence et Marges de la
Philosophie.
367. Et de mes vingt-et-un ans, m’être surpris d’une réflexion normalisante
et proto-raciste : « Que fait dans un lieu comme la galerie Saatchi
du personnel de nettoyage en ces heures d’ouverture au public ? »
avant de m’aviser qu’il s’agissait bien d’une sculpture, tout à fait à sa place
dans un tel lieu de “prestige”.
368. Husserl,
Méditations cartésiennes, 5.55,
p. 201.
369. Jean-Luc Mélenchon, en hologramme à Paris devant
six-mille personnes, le 5 février 2017, alors qu’il tenait en même temps meeting “en chair et en os” à Lyon,
devant une assistance double.
370. Husserl,
Méditations cartésiennes, 5.56,
pp. 208-209.
371. Voir idem, 5.58, pp. 213-219.
372. Voir Entre-deux,
même partie de l’étude, infra.
373. Husserl,
Méditations cartésiennes, 5.56,
p. 211.
374. Le film The
Artist is Present choisit deux moments semblables : une jeune homme
encapuchonné de noir qui place devant son visage un tableau ; une jeune
femme qui se met à nu, soulevant sa robe ; tous deux rapidement éclipsés
par le dispositif sécuritaire du MoMA. L’assistant d’Abramović commente en
regrettant que la performance devienne, pour certains, une scène “pour se faire
valoir”, voire émettre un acte artistique. Les conditions et la “loi” sont ici
clairs : il n’y a qu’une artiste, Marina, sont vis-à-vis est
asymétriquement un non-artiste, n’a pas droit au performatif.
375. Husserl,
Méditations cartésiennes, 5.58, pp. 213-219.
376. Ce malgré ce que certains seront tentés de nommer comme
des compromissions avec le pouvoir : la rétrospective du MoMA d’abord,
l’alliance avec des stars du show-business ensuite (Jay-Z, Lady Gaga, Deborah Harry), et pour finir l’étrange show de An artist’s life Manifesto au repas de gala des donateurs du Musée
d’art contemporain de Los Angeles (MoCA). Dans les “concessions” semblent
toujours pouvoir se lire une distance critique de Marina Abramović
– qui parle de “side effect”
– et une sorte de renvoi ironique. Il y a de sa part construction du
compromis, indispensable à l’existence même de son art – sinon “The great artist of tomorrow will go [and
remain] underground” et rester inconnu. Le choix d’Abramović
étant celui d’un art performatif, public, ce public – et dès lors le
compromis de la publication et de la publicité ; ainsi que celui de
l’institution publique du marché de l’art, des galeries, foires et musées
– est absolument nécessaire.
377. Voir Rhythm 0, où bien
entendu c’est la capacité de violence de chacun qu’elle teste, mais aussi le
contrôle social qui s’établit entre chacun et empêche pour tous cette violence
– élément à développer ; Rhythm
5 interroge bien entendu l’Etat communiste, de par l’étoile asphyxiante en
feu au centre de laquelle elle se couche, mais aussi par le lieu même de la
performance (le cercle étudiant et culturel de Belgrade). Tomas Lips questionne autant L’Etat que son passé familial (ses
parents, résistants et partisans communistes ; sa grand-mère orthodoxe
pratiquante), alors que la grande majorité des performances avec Ulay
interrogent le rapport de domination et de pouvoir de l’homme sur la femme
– qui même répondant en reste passive et sous la menace de l’arme
masculine comme dans Rest Energy.
378. Marina Abramović, dans The
Artist is Present, film.
379. Husserl, Problèmes
fondamentaux de la phénoménologie, § 38, L’empathie
et § 39, L’acquisition d’autres Je
phénoménologiques, pp. 204-210.
380. Extrait de la partie titrée Point
de vue de
cette étude.
381. Extrait de la partie titrée Vues
répétées de
cette étude.
382. Extrait de la partie titrée Vue transitive de cette étude.
383. Voir
Theodor Lipps, Einfühlung, innere Nachahmung,
und Organempfindungen>.
384. Voir Robert
Vischer, Über
das optische Formgefühl, ein Beitrag zur Ästhetik [Le sentiment optique de la forme, Contribution à l’esthétique].
385. Voir Jean Decety, Naturaliser l’empathie, in
« L’Encéphale, 28 », pp. 9-20.
386. Voir Laurent Wispé, The distinction between sympathy
and empathy, in « Journal of Personality and Social
Psychology, 50, 2 », pp. 314-321.
387. Levinas, Diachronie et
représentation, op. cit. , pp. 169-170.
388. Idem, p. 171.
389. Idem, pp. 173-174.
390. Dans la partie titrée Vues répétées de cette étude. La citation est extraite de Maurice Blanchot, La pensée et l’exigence de discontinuité, in
« L’Entretien infini », pp. 5-8.
391. Ce qui marqua l’abandon de toute pratique, entre 1997 et 2014, hors la
co-création d’une école de multimédia (et d’art) et l’enseignement (considéré
comme art).
392. Marcel Duchamp, clôture
de son interview par Georges Charbonnier,
Entretiens avec Marcel Duchamp.
393. Levinas, Diachronie et représentation, pp. 173-174.
394. Extrait de la partie titrée Entre-temps de cette étude.
395. Le film The
Artist is Present montre cet espace-temps d’oubli, qui se manifeste en
particulier chaque soir, juste en fin de performance, le dernier public
parti ; Abramović se repliant sous sa chaise,
avant de sortir de l’espace – en un état “hallucinatoire“ où toute
décision – et poursuite de la décision – s’abolit.
396. Levinas, Diachronie
et représentation, pp. 177-178.
397. Levinas, Totalité
et infini, pp. 220-221.
398. Jean-Pierre Levebvre, annotations à Atemwende [Renversement du souffle] de Paul Celan, p. 187
399. Levinas, Totalité et
infini, pp. 221-222
400. « La question, si elle est parole inachevée, prend appui sur
l’inachèvement. Elle n’est pas incomplète en tant que question ; elle est,
au contraire, la parole que le fait de se déclarer incomplète accomplit. […] La
réponse est le malheur de la question. […] La question attend la réponse, mais
la réponse n’apaise pas la question et, même si elle y met fin, elle ne met pas
fin à l’attente qui est la question de la question. […] C’est bien pourquoi la
“question la plus profonde” est toujours réservée […]. La question la plus
profonde est telle qu’elle ne permet pas qu’on l’entende ; on peut
seulement la répéter, la réfléchir sur un plan où elle n’est pas résolue, mais
dissoute, renvoyée au vide d’où elle a surgi. C’est là sa solution : elle
se dissipe dans le langage même qui la comprend.
[…] Ce qui est, dans le monde de la maîtrise, de la vérité et du pouvoir,
question d’ensemble est, dans l’espace de la profondeur [de la question la plus
profonde] question panique. […] Le questionnement nous met en rapport avec cela
qui se dérobe à toute question et excède tout pouvoir de questionner. […]
[…] “La question la plus profonde” est la question qui échappe à la
référence de l’Un […] C’est l’autre question, question de l’Autre, mais aussi
question toujours autre. »
Maurice Blanchot, La Question la plus
profonde in « L’Entretien infini », op. cit. , pp. 14-34.
401. Levinas, Totalité et
infini, p. 223.
402. Dans le contexte d’un tel dialogue sur une performance de Marina
Abramović, il convient sans doute de rappeler que l’alphabet
cyrillique l’emporte sur le romain. Ainsi, si l’image est latine,
romano-germanique et catholique ; l’icône est grecque, byzantino-slave et
orthodoxe. Il est dès lors possible que, là où nous pensons image, imago – imaginem – et constitution de l’image dans l’ego (le soi vis-à-vis de Marina) ;
elle pense icône, eikon – εἰκόνα
– et effet relationnel de l’icône entre deux ego (dans le vis-à-vis). Le concept d’économie – οικονομία – se construit
du grec konomia – κονομία– relation commune à la nomination. Pour
un développement de la notion d’“oikonomia”
voir Marie-José Mondzain, Image, icône,
économie, en particulier le chapitre II, Etude sémantique, pp. 33-90, dont sont extraites ici quelques
citations afin d’en expliciter le concept patristique, qui est non “économique”
au sens pratique – pragmatique – ou “fonctionnaliste” (Habermas), marxiste
ou tel qu’employé dans le sens commun actuel.
« Le Dieu de l’économie se distribue, se dépense, se fait connaître.
Devenu visible, il se déclare avec un visage – prosopôn –, terme par lequel on désigne justement les
personnes de la sainte Trinité. C’est l’économie hypostatique de la divinité.
« Par rapport au face-à-face toujours cherché et toujours impossible entre
Dieu et sa créature qui caractérise l’Ancien Testament [Levinas ?], c’est
l’ouverture du champ historique, celui d’un face-à-face, d’un échange de
regards désormais possible et qualifié d’énigmatique [et non plus comme
mystère] » (p. 38)
« La différence entre la théologie et l’économie, c’est la différence
qui existe entre croire sans voir et croire en voyant. Parler de la Trinité ne
sera possible qu’en utilisant l’économie du discours, c’est-à-dire dans la
maîtrise de l’écart qui, pour toujours, séparera l’orateur de l’essence de son
objet. Il ne pourra l’atteindre que relativement. »
(p. 40)
« La manifestation se dit ici épideixis.
L’économie détermine un champ propre à la parole et à la monstration. Ce champ
ne met pas fin au mystère de ce qui le détermine, il y donne accès à la parole
et à la visibilité. » (p. 41)
« La communauté de nom (koinomia)
sera soutenue par la relation économique (skhésis)
qui relie le mot, la chose signifiée et l’image. L’image [au sens d’icône] créé
un lien qui n’est ni naturel ni artificiel entre le signifiant et le signifié.
Ce lien est économique, c’est-à-dire de similitude relative. » (p. 47)
« L’économie de la chair, c’est l’intérieur invisible du corps [Leib] devenant soudain visible pour
délivrer le vrai message économique de la Rédemption. Elle est l’organon, l’organe et l’épiphanie […]
n’opère pas comme une simple dissection, mais comme une transfiguration. »
(p. 61)
« La chair véritable, celle qui vit dans la parole et dans l’image
[icône], ne relève pas de l’apparence [imago]
mais de l’apparaître [εἰκόνα],
là où l’ordre de la manifestation vient au bout de tous les pièges de
l’illusion. La chair participe à la parousie de l’être en maintenant avec lui
un écart. […] [L’icône] reflète
[l’être] en énigme devenant ainsi
l’indice et la preuve vivante de l’existence de ce à quoi elle “remonte” (diabainein). L’icône échappe à la
fonction de désignation, c’est elle qui sera désignée » (p. 90)
« Telle est l’étrange situation qui conduit à formuler
pour la première fois ce qu’est un tableau.
Dire que [l’icône] a voulu être tableau, et non idole ou représentation, c’est
dire qu’elle instaure un regard et non point un objet. Participant toute
entière du règne paulinien de la similitude et de l’énigme, elle ne vise pas
d’autre “ressemblance” que l’assimilation,
l’ad-similation du voir à l’être vu. » (p. 96, deuxième section, Economie iconique – doctrine de l’image et de
l’icône).
403. Levinas, Totalité et
infini, pp. 236-238.
404. Idem, p. 323.
405. Idem, p. 331.
406. Idem, p. 334.
407. Heidegger, Remarques sur art,
sculpture, espace, p. 27, « L’espace espace. »
408. A ce demander si dans l’emploi constant du “gaz” chez Duchamp, dans
les titres, dans ses flux réels ou imaginés, dans les lampes, n’appelle pas “The gaze” – le regard, avec ce
même inflexion de la distance en élévation.
409. Heidegger, Der Ursprung des
Kunstwerkes [De l’origine de l’œuvre d’art], version 1931-32, trad. Rialland, version électronique. Le recours à cette version, préparatoire à
la conférence de 1935, texte traduit par Martineau, montre que la faute
heideggérienne remonte à avant l’état nazi (Heidegger vote pour le NSDAP en
1932 et adhère au parti en 1933, juste avant la nomination d’Hitler comme
chancelier), et que cette faute anticipe son rectorat à l’Université de
Freiburg (1933-1934) et le discours d’intronisation qu’il y tint. Voir Discours du rectorat, trad. Fédier,
in « Écrits
politiques, 1933-1966 ».
410. Sur
l’emploi de langue pour langage, ces passages du texte lèvent tout
ambiguité ; Heidegger pense “langue”-
et en particulier – deutlich
– die Deutschsprache :
»
[…] Zum Beispiel das Bauen eines bestimmten Zeustempels oder das hinstellen,
zum Stand-Bringen eines bestimmten Apollostandbildes oder die Aufführung einer
Tragödie, die zugleich aber nicht nur die Errichtung eines dichterischen
Sparchwerkes in der Sprache eines Volkes ist. […] Die Dichtung Hölderlins steht
[…] wirklicher in der Sprache unseres Volkes […], in ihr den Deutschen die noch
unbetretene Mitte ihrer Welt und ihrer Erde bereitet ist und große Entscheidungen
aufgespart.
« […]
Par exemple la construction d’un temple voué à Zeus, l’élévation d’une statue
d’Apollon, ou la représentation d’une tragédie, laquelle est toujours en même
temps l’action d’ériger une œuvre poétique langagière dans la langue d’un
peuple. […] La poésie d’Hölderlin […] se tient dans la langue de notre peuple
[…] en elle, pour les Allemands, le milieu encore inexploré de leur monde et de
leur terre se conserve et des décisions importantes se préparent. »
Il
s’agit bien, dans la pensée d’Heidegger de Sprache
comme langue particulière d’un “peuple” et non comme langage commun à
l’humanité – erreur fatale ouvrant la voie au national-socialisme du
peuple et à un guide qui en serait “le dieu”.
411. « Le
langage sans doute est fait de lalangue. C’est une élucubration sur lalangue.
Mais l’inconscient est un savoir, un savoir faire avec lalangue. Et ce qu’on
sait faire avec lalangue dépasse de beaucoup ce dont on peut rendre compte au
titre du langage. » Lacan, Encore, séminaire XX, p.
127.
412. Levinas,
Totalité et infini, pp. 226-227.
413. Idem, pp. 228-229.
414. Idem, pp. 233-234.
415. Levinas, Diachronie et représentation, p. 180.
416. Levinas, Totalité et infini, pp. 324-325.
417. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes [De l’origine de l’œuvre d’art], version 1931-32.
418.
Heidegger, Remarques sur art, sculpture,
espace, pp. 28-31, “humain” remplace la traduction de “Mench” par “homme”.
419. Heidegger,
Der Ursprung des Kunstwerkes [De l’origine de l’œuvre d’art], version 1931-32.
420. « À la seule condition d'un
élargissement radical des définitions sera-t-il possible pour l'art et les
activités liées à l'art [de] fournir la preuve que l'art est aujourd'hui le
seul pouvoir évolutif révolutionnaire. Seul l'art est capable de démanteler les
effets répressifs d'un système social sénile qui continue de chanceler au bord
de la falaise : démanteler pour construire "un organisme social comme
une œuvre d’art” [soit une “sculpture sociale”]… Chaque être humain est un
artiste qui – de son état de liberté – la situation de liberté dont
il fait directement l'expérience – apprend à déterminer les autres
situations de l’œuvre d’art totale du futur ordre social ». Joseph Beuys, 1973, publié en anglais dans Caroline
Tisdall, Art into Society – Society
into Art.
421. Artaud, Pour en finir avec le
jugement de dieu, Etats préparatoires IV, p. 149.
422. Voir L’Espace
public et Théorie de l’agir
communicationnel.
423. En ce sens, les tours jumelles du World Trade Center faisaient bien “œuvres” au sens du premier
Heidegger :
« L’édifice
[du temple] embrasse la figure du dieu [Port
Authority, commerce et finance et spéculation], et, en même temps, il la
laisse ainsi émerger, à travers la colonnade ouverte, dans l’espace consacré.
Dans le temple et par le temple, le dieu manifeste sa présence, et c’est ainsi
seulement qu’il laisse le domaine s’étendre et se délimiter comme un domaine
sacré. Bien loin que la présence du dieu se perde dans l’indéterminé, c’est au
contraire le temple qui, pour la première fois, joint et rassemble l’unité
de ces rapports où s’ajointent la naissance et la mort, l’heur et le malheur,
la victoire et l’humiliation, l’unicité et le déclin d’un peuple. L’unité
régnante de ces rapports, nous l’appelons un monde. C’est au sein de
celui-ci qu’un peuple, à chaque fois, accède à lui-même. Le temple comme œuvre
est le milieu ajointant de toutes les jointures de tout monde. » (p. 31)
« L’œuvre-temple,
en se dressant là, porte le peuple à la conjonction de son monde. En même
temps, il laisse la terre se lever comme le fond natal sur lequel son Dasein
repose. Cependant, les hommes et les animaux, les plantes et tout le reste
ne sont pas là sous la main, comme des choses fixes et bien connues qui ensuite
fourniraient seulement au temple — lui-même sous la main un jour ou
l’autre — son environnement. Tout, ici, est renversé [au point que Manhattan n’est plus que terre
domestiquée, n’a plus de terre, n’est plus terre,
est aboutie comme monde] : c’est le
temple, dans sa tenue, qui donne pour la première fois aux choses le visage
grâce auquel elles deviendront à l’avenir visibles et, pour un temps, le
demeureront. » (p. 33)
Heidegger,
De l’origine de l’œuvre d’art, version 1935, trad. Martineau.
De fait la
destruction des tours jumelles, par attaque terroriste, est non seulement
signifiante, mais ouvre un nouveau signe : Ground Zero (comme si la nomination annonçait déjà la promesse, au
travers la mort, le malheur, l’humiliation et le déclin – zero –, d’un re–commencement depuis un
fondement Ground qui est abîme
– Abgrund –. Les gouffres
jumaux de Ground zero sont un “espace
qui espace” – Raum raümt
– “œuvre” au sens du second Heidegger :
« Mais que deviendrait le
vide de l'espace ? Assez souvent, ils apparaissent seulement comme une
déficience. Le vide est alors considéré comme un manque à remplir, une cavité
ou un entre-espaces (Zwischenraumen).
On peut supposer,
cependant, le vide comme proche apparenté au caractère du lieu, il n’est alors
plus un manque, mais une production-apportante (ein
Hervorbringen)
[…]
Dans le verbe “vider” (leeren)
est dit le mot “cueillir-rassembler”, (lesen) dans le sens originel de la
collecte, qui règne dans le lieu. […]
Le vide n’est pas rien. Il n’est pas déficience. […] Le vide
joue à la manière d’un cherché-projectif (suchend-entwerfenden)
fondatrice de lieux.
[…] Les lieux, préservant et ouvrant une région, recueillent
du libre autour d’eux, ce qui accorde un séjour à chaque chose et une demeure aux
hommes, au milieu des choses. »
Heidegger, Die Kunst
und der Raum [L’Art et l’espace], 1969, ma traduction.
424. Paul
Eluard, Pour vivre ici, IV, in
« Le Livre ouvert
(1938-1944) », p. 102.
425.
Adorno, Théorie esthétique,
trad. Jimenez, p. 336.
426. Pierre Dumayet, Le
Drame d’un réducteur de tête, entretien avec Giacometti, in « Le
Nouveau Candide, 110, 1963 », réédité in « Alberto Giacometti, Pourquoi je suis sculpteur », pp.
45-54.
427. « Le moy eſt haïſſable. », Pascal, Pensées diverses II, Fragment n° 5 / 37, p. 106. « L’enfer c’est les Autres »,
phrase du personnage de Garcin, dans Huis
clos, scène 5, p. 93, de Jean-Paul Sartre.
428.
Envers et endroit, inframine et la notion de moule rappellent Marcel Duchamp.
429.
Sur l’Eternel retour, voir Nietzsche, Le Gai Savoir, § 341.
430. Voir
la part de cette étude titrée R’ aperçu
et pour l’intégralité de la scène chez James Joyce, Ulysses, pp. 328-376
431. Lyotard, Après le
sublime, état de l’esthétique, op.
cit.
432. Carl
Gustave Carus, Neuf lettres sur la
peinture de paysage, op. cit. Lettre VI, p.104.
433. Lyotard,
Après le sublime, état de l’esthétique.
434.
Savoirs, savoirs-faire et savoir-êtres, ce recouvrant plus ou moins une théorie
des trois mondes de Popper : les savoirs s’appliquent à une connaissance
des mondes objectifs et sociaux, les savoirs-faire à l’efficacité des actions
du monde subjectif dans les mondes objectifs et sociaux, le savoirs-être à
l’adéquation des actions du monde subjectif dans le monde social. (Voir Popper,
La connaissance objective).
435.
Merlau-Ponty, L’Œil et l’esprit, p.
23.
436.
Héraclite, fragment rapporté par Plutarque, Sur
les oracles de la Pythie, in « Les Débuts de la philosophie »,
textes édités, réunis et traduits par Laks et Most, p. 273.
437. Nietzsche,
Dédicace à Richard Wagner, fragment
posthume 11(1), op. cit.
438. Risque
dont nous retient, depuis Parménide, toute pensée rationnelle. Il ne semble
ainsi pas que la déesse dicte au poète que le non-être n’est pas, mais bien
qu’il est inabordable – et qu’autant vaut-il ne pas y songer.
« Allons,
moi je te dirai […]
Quelles
sont les seules voies de recherche à penser :
L’une que
‘est’ et qu’il n’est pas possible que ‘n’est pas’,
Est la
route de la persuasion (elle accompagne en effet la vérité) ;
L’autre,
que ‘n’est pas’ et qu’il est nécessaire que ‘n’est pas’,
Je t’indique
qu’elle est le chemin totalement dépourvu d’information.
Tu ne
saurais en effet connaître ce qui n’est pas (c’est en effet impratiquable)
Ni
l’indiquer. Car c’est la même chose que penser et être. »
Fragment 1, rapporté par Proclus, Commentaire du Timée de Platon et Clément d’Alexandrie, Stromates.
La déesse
ne dit pas explicitement que le non-être n’est pas. Elle dit qu’il est
impensable, dépourvu de toute information – par la suite de possibilité
de communication ou d’agir –, que le chemin qui y mène est impratiquable.
L’art prend le risque de cet impraticabilité.
« […]
Car l’impuissance dans leur
Poitrine
guide leur pensée errante ; et ils sont emportés,
Sourds non
moins qu’aveugles, ahuris, tribus indécises
Qui
tiennent que ‘ceci est et n’est pas’ est le même
Et pas le
même, et que de toutes les choses le chemin est réversible. »
Fragment 2, rapporté par Simplicius, Commentaire de la Physique d’Aristote
Et si c’est
la voie de l’art, ainsi va, tel le devin, le prophète, l’artiste – et
ceux qui “l’écoutent”.
« Aucun
moyen que jamais tu ne domptes ceci – que des choses qui ne soient pas
soient.
[…] écarte
ta pensée de cette voie de recherche,
Et que
l’habitude et ses multiples expériences ne te contraignent pas sur cette voie
[à savoir
que nous expérimentons chaque jour la mortalité d’autrui – passant d’être
à non-être]
A laisser
paraître un œil sans but […]
[L’a–perception
même qui est ici posée]
[…] mais
décide par l’argument de la réprobation hautement disputée
Que j’ai
formulée. Seul subsiste encore le mot de la voie :
‘Est’. Sur
celle-ci existent des signes
En très
grand nombre, qu’étant est inengendré, indestructible,
Intègre,
seul de son [eccéité], sans tramblement et sans fin.
[Et l’a
– perception est niée par l’argument de la raison]
[…]
[…] La
décision (krisis) sur ces points
dépend de ceci :
‘Est’ ou
‘n’est pas’. Or, il a été décidé, comme il est nécessaire,
D’abandonner
l’une comme impensable et sans nom (car elle n’est pas la vraie
Voie), et
en conséquence que l’autre existe et est réellement.
[nécessaire
ne comprend pas “possible” et l’abandon de la voie du non-être se décide parce
qu’il est impensable – et non n’est point]
[…] car la
puissante Nécessité
Le
maintient dans les entraves de la limite, qui l’enserre alentour
Ce pourquoi
il n’est pas permis que ce qui est soit incomplet.
[et hors
cette limite – voir plus loin “sa limite est extrême” –, alors,
non-enserré est l’infini néant, “qui manque de tout” sauf de lui]
[…]
Car c’est
la même chose que penser et la pensée que ‘est’
[Et que
‘n’est pas’ est impensée]
Car sans ce
qui est, en quoi est proféré,
Tu ne
trouveras pas le pensé. Car rien d’autre n’est ou ne sera
A côté de
ce qui est, puisque celui-ci, Destinée l’a lié
De façon à
ce qu’il soit intègre et immuable : c’est pourquoi seront nom
Toutes les
choses dont les mortels ont posé, persuadés qu’elles sont véridiques,
Qu’elles
naissent et disparaissent, sont et ne sont pas,
Changent de
lieu et modifient leur brillante couleur.
[Ainsi,
affirmer l’être n’est rien d’autre que d’affirmer la possibilité de penser et
de dire – de communiquer et d’agir – et ne dit rien d’une
possibilité du non-être, sinon qu’il est impossibilité de penser et dire, de
communiquer et d’agir]
De plus,
puisque sa limite est extrême, il est achevé
De partout,
semblable au volume d’une balle au bel arrondi,
Partout
également équilibré en partant du centre ; car il faut qu’il ne soit
Ni en rien
plus grand ni en rien plus petit ici que là.
[Autant
extrême soit cette limite, limite il y a – et ce qui en “déborde” est
bien hors être ; par contre ceint dans sa limite, l’être est préservé du
non-être]
Car il n’y
a pas de non-être qui pourrait l’empêcher d’atteindre
Son
semblable, ni non plus de l’être tel qu’il y ait de l’être
Plus ici et
là moins, puisqu’il est tout entier inviolable.
Car, égal à
lui-même de partout, il se tient dans ses liens, semblablement.
[Tautologique,
il affirme le Même et exclu tout Autre.]
[…]
[…] à
partir de là, apprends les opinions mortelles
En écoutant
l’arrangement trompeur de mes paroles.
Ils ont en
effet posés des formes, deux, pour nommer leurs visées
Dont l’une
n’est pas nécessaire : ce en quoi ils errent ;
[non-nécessaire
l’errance reste possible – et cette possibilité est la voix de l’oracle,
du prophète, du poète et de l’art]
Et ils ont
distingués leur corps comme des opposés et posé des signes
Séparés les
uns des autres : pour l’une, le feu éthéré de la flamme,
[…]
A l’opposé,
nuit sans connaissance, corps dense et pesant.
Cet
arrangement du monde, adapté en tout point, je l’énonce pour toi.
De sorte
que jamais une conception d’homme mortel ne te dépasse.
[Ce que la
déesse pose n’est pas l’impossible, c’est l’interdit : le non-être est
in–ter–dit ; “il faut le taire”]. »
Fragment 3, rapporté par Platon, Sophiste ; Sextus Empiricus, Contre les logiciens et Simplicius, Commentaire de la Physique d’Aristote.
Parménide, in « Les Débuts de la
philosophie », op. cit. , pp.
549-553.
439. Samuel
Beckett, En attendant Godot, fin de
l’acte deuxième, pp. 131-134.
440. Marcel
Duchamp, dans le film de Jean-Marie Droz,
Jeu d’échec avec Marcel Duchamp, dernière phrase de l’entretien.
441. Cornelius
Castoriadis, La Culture dans une société
démocratique, in « La Montée de l’insignifiance », p. 202.
442. Paul
Eluard, Yeux, in « Donner à
voir », p. 36.